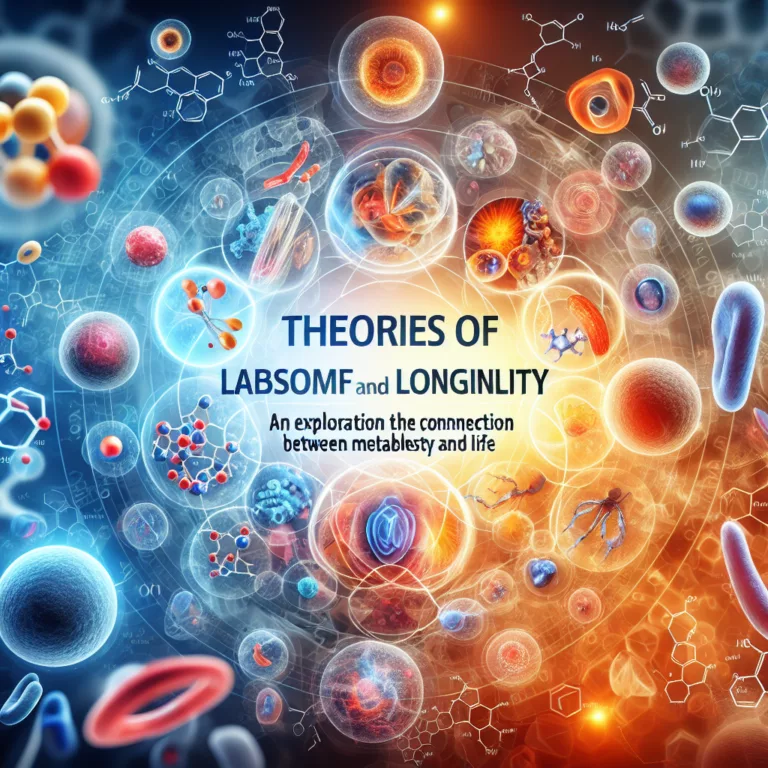L’Héritage de Mikhail Blagosklonny : La Théorie de l’Hyperfonction et le Vieillissement
Mikhail Blagosklonny, un éminent scientifique, a profondément influencé le débat moderne sur les causes de l’âge, notamment par sa théorie de l’hyperfonction. Après sa mort, il est pertinent de réfléchir à ses contributions et à son dialogue avec d’autres chercheurs, tels qu’Aubrey de Grey. Blagosklonny a affirmé que l’hyperfonction, plutôt que l’accumulation de dommages, est…