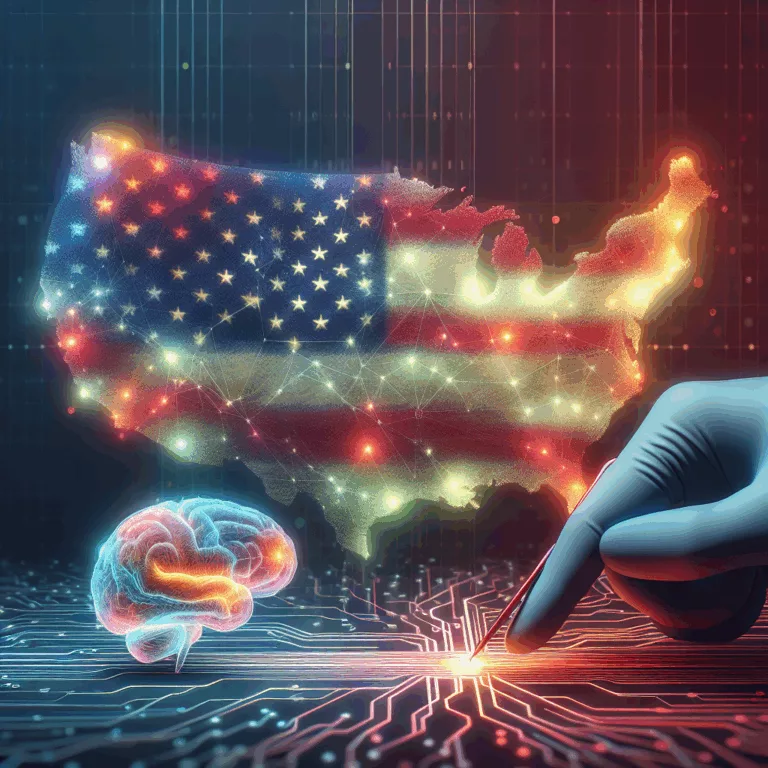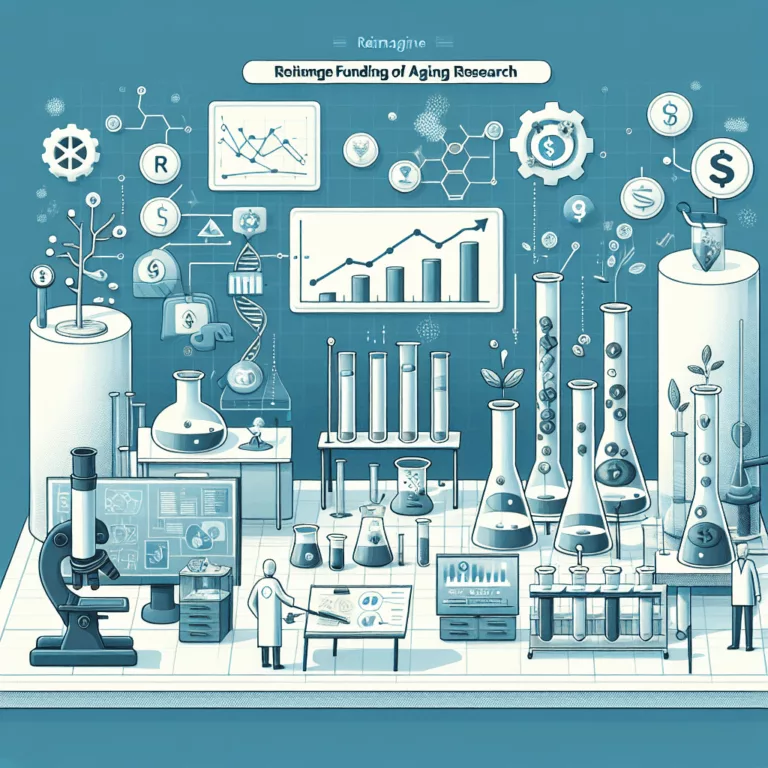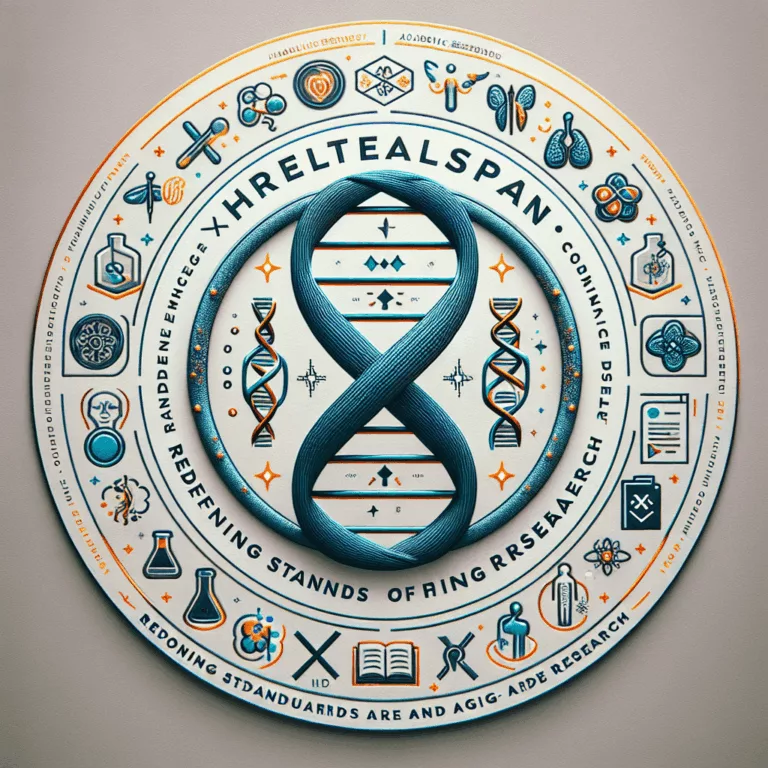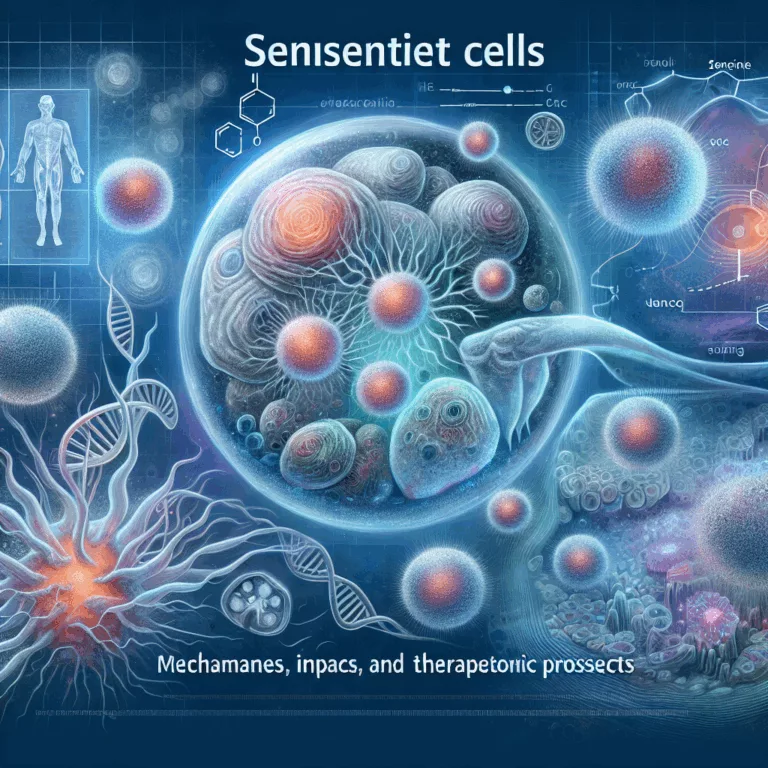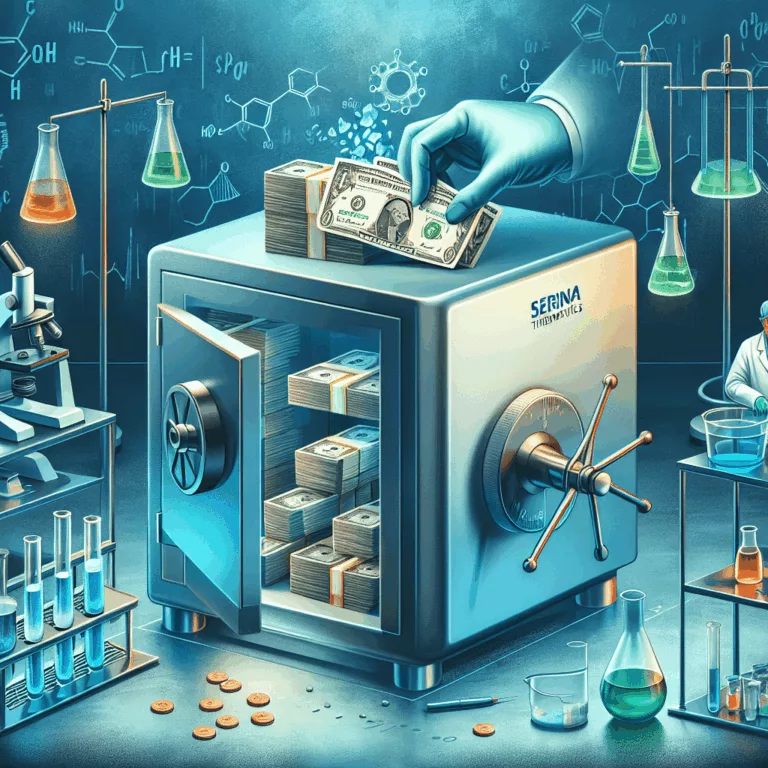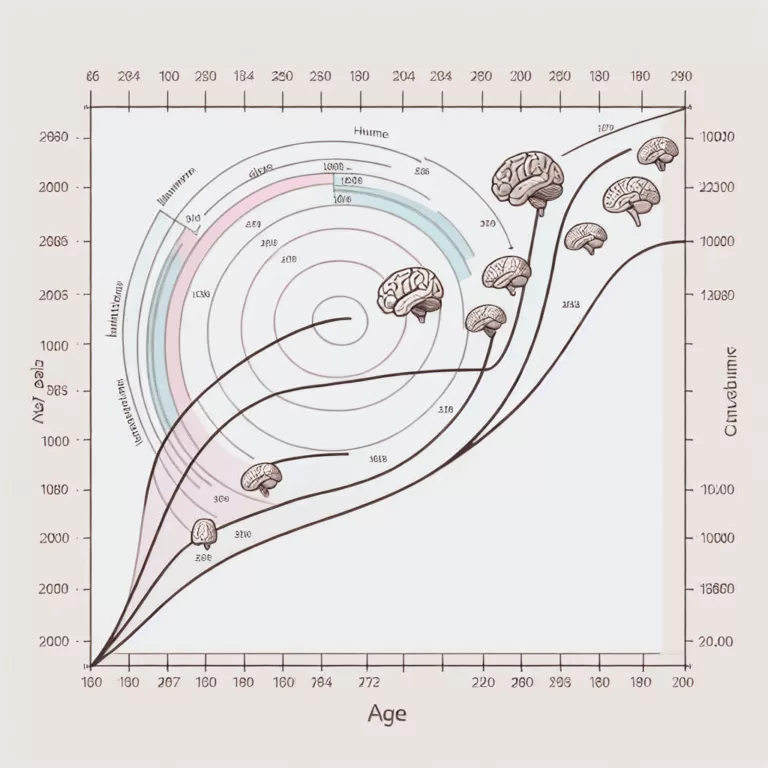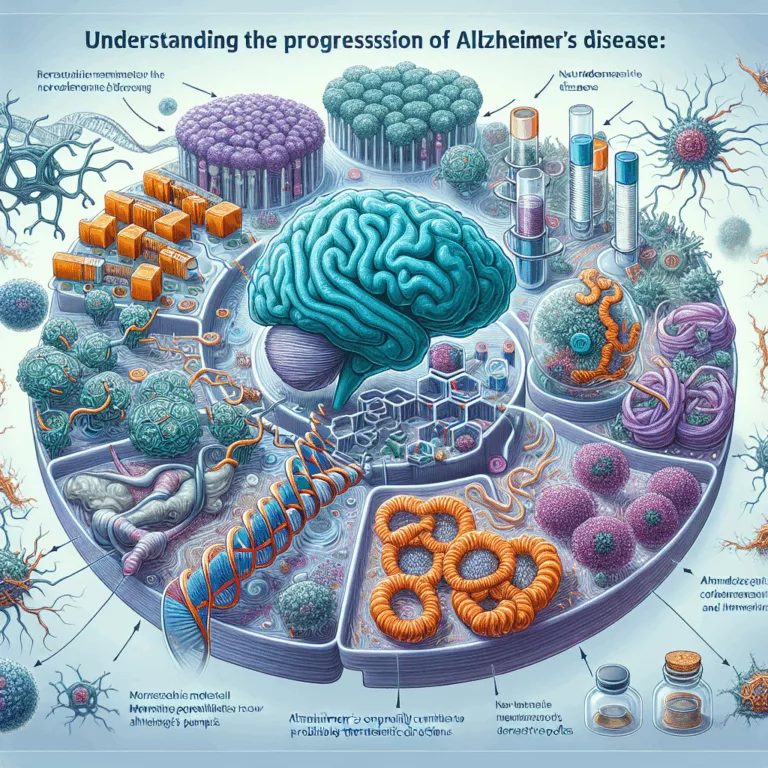Amélioration de la régénération des axones périphériques : Une avancée dans la recherche sur le vieillissement
Découvrez comment une nouvelle recherche révolutionne la régénération des axones périphériques, promettant de transformer les traitements liés au vieillissement.