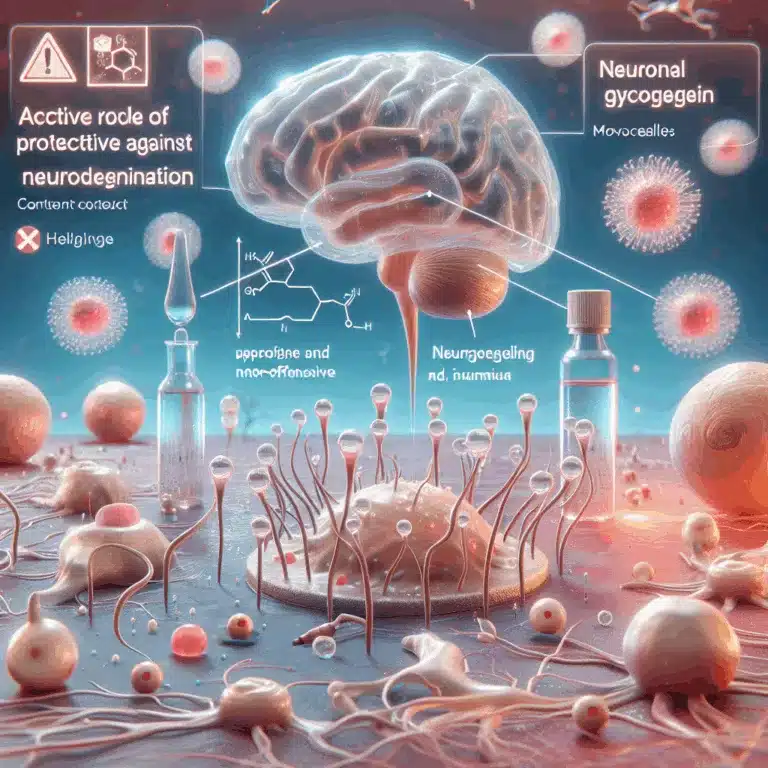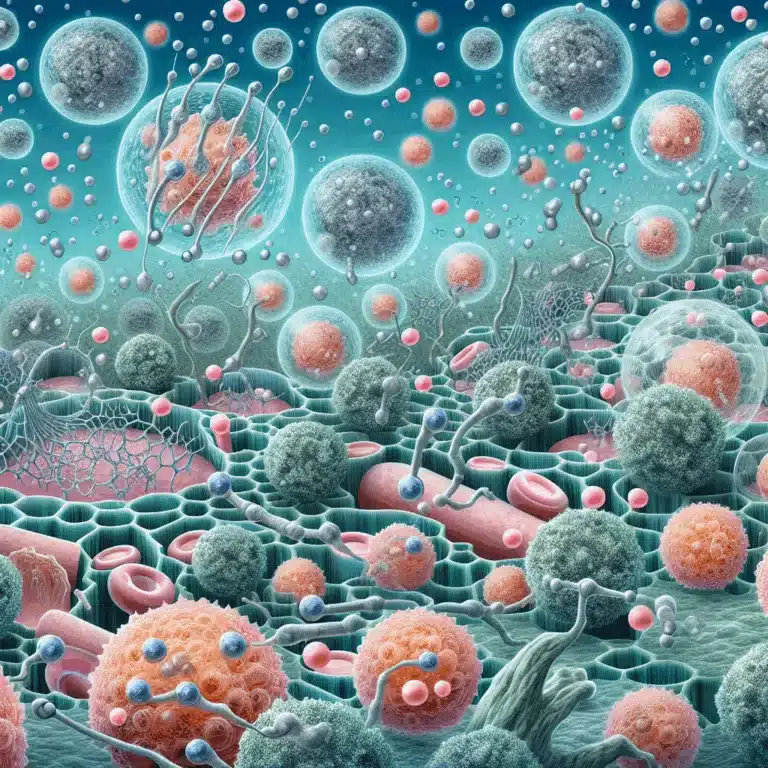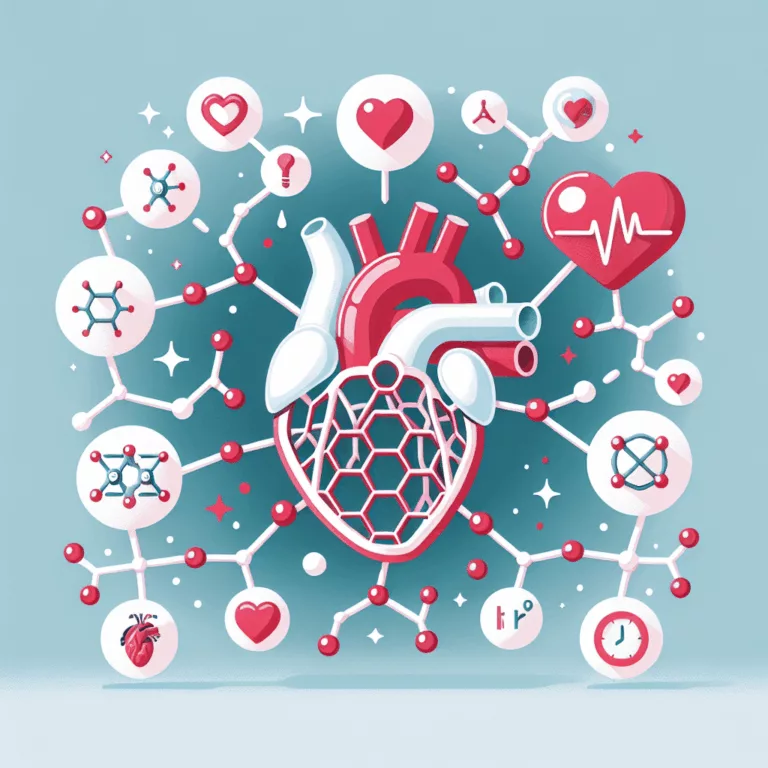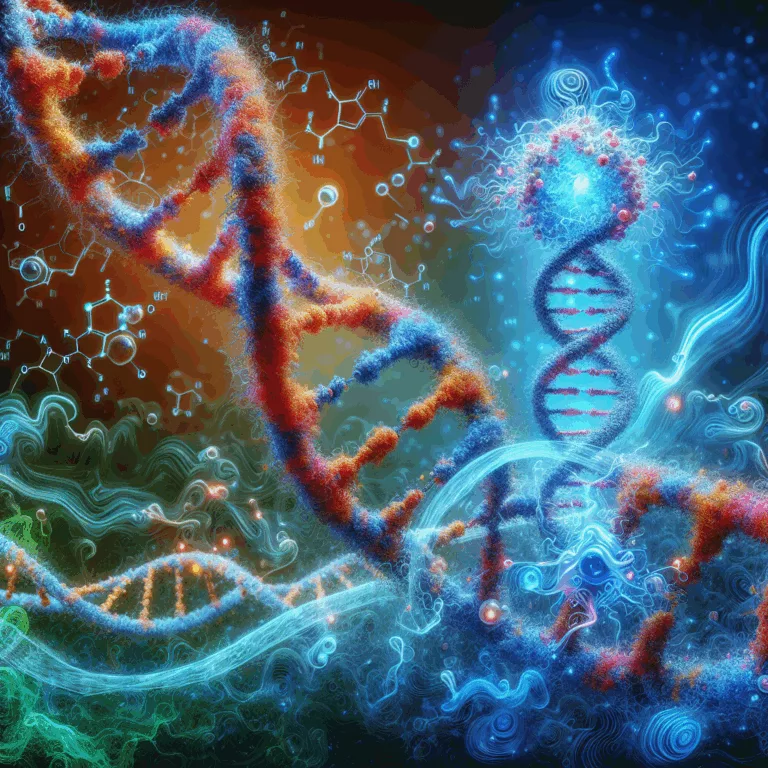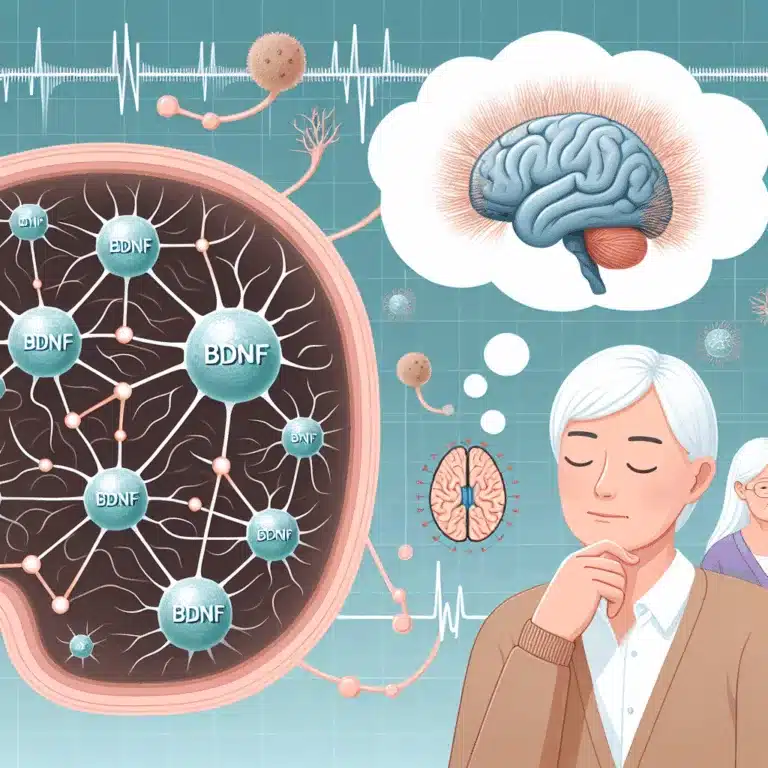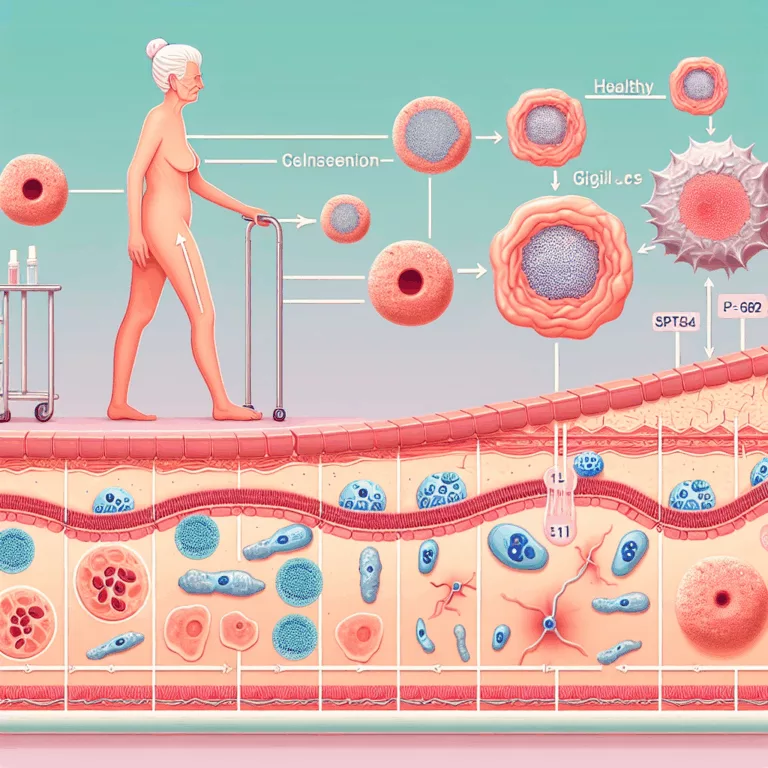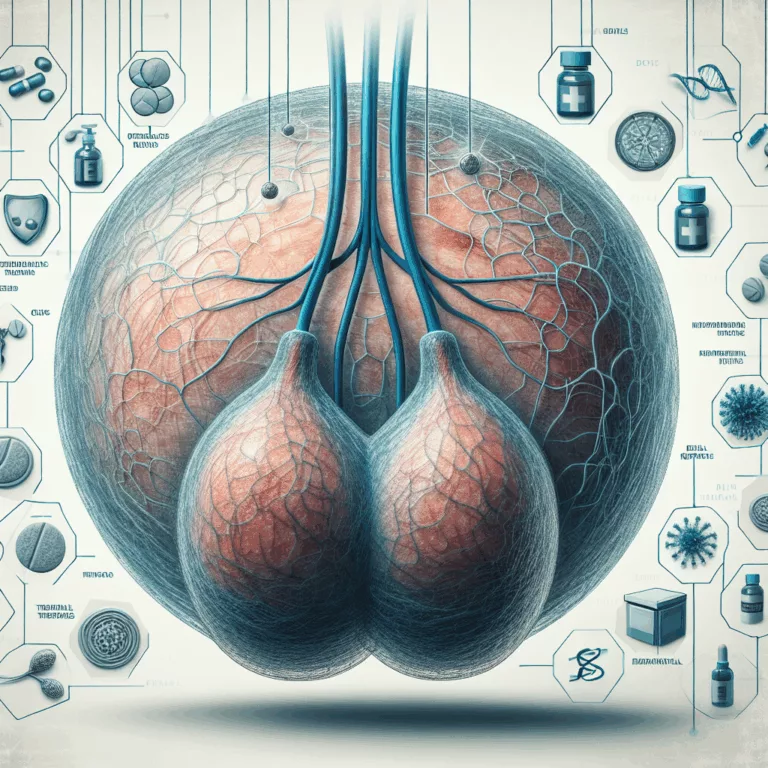Le rôle actif du glycogène neuronal dans la protection contre la neurodégénérescence
Une étude récente menée par le Buck Institute for Research on Aging a révélé que le glycogène, traditionnellement considéré comme une simple réserve d’énergie dans les neurones, joue un rôle actif dans la lutte contre les maladies neurodégénératives telles qu’Alzheimer et la démence frontotemporale (DFT). Cette recherche, publiée dans Nature Metabolism, montre que dans les…