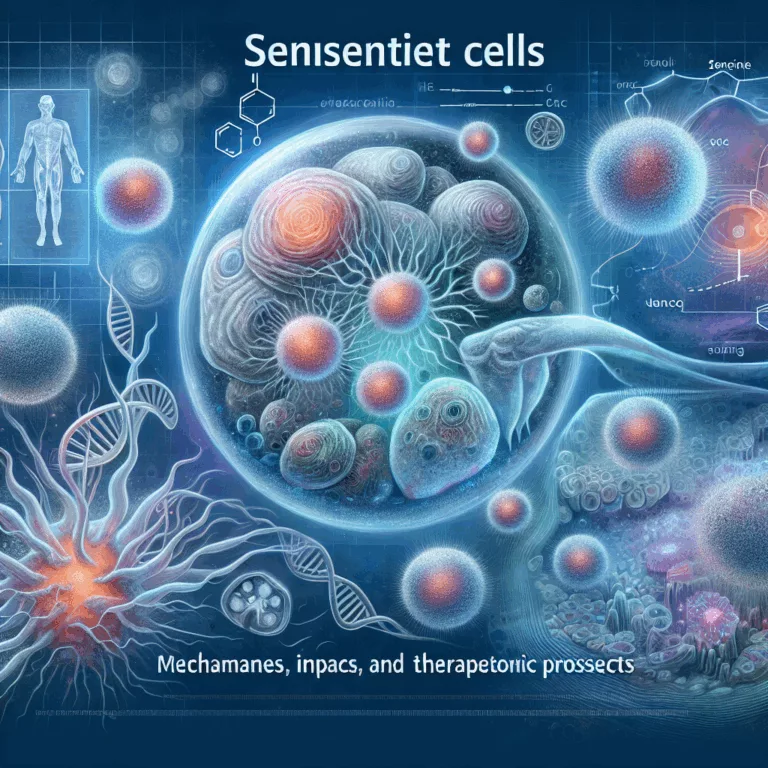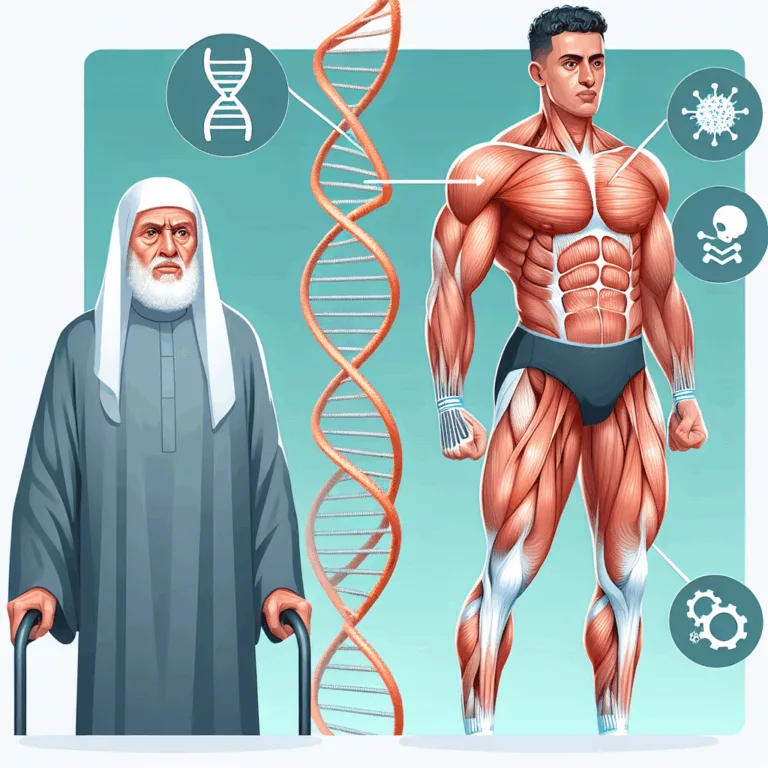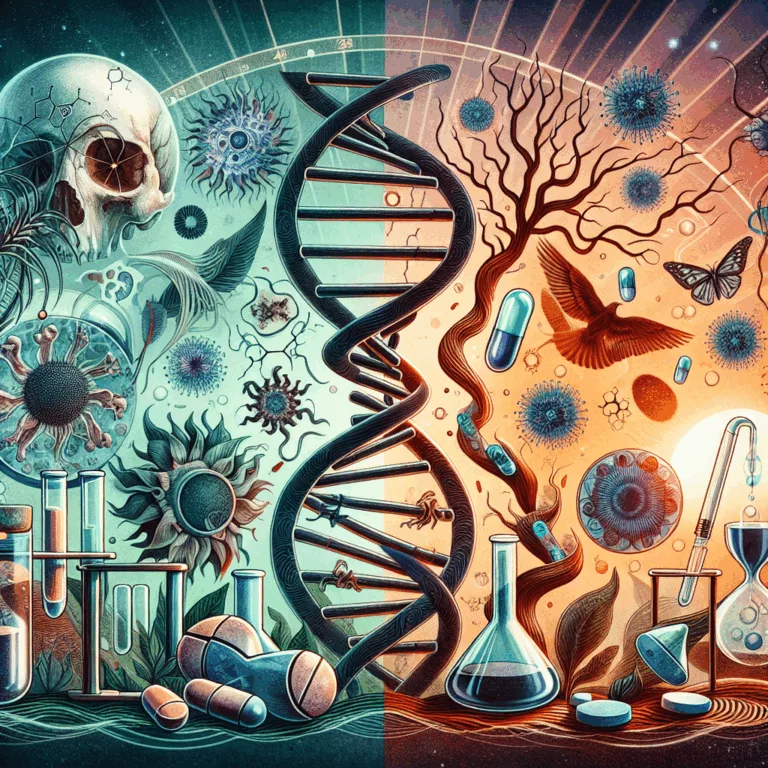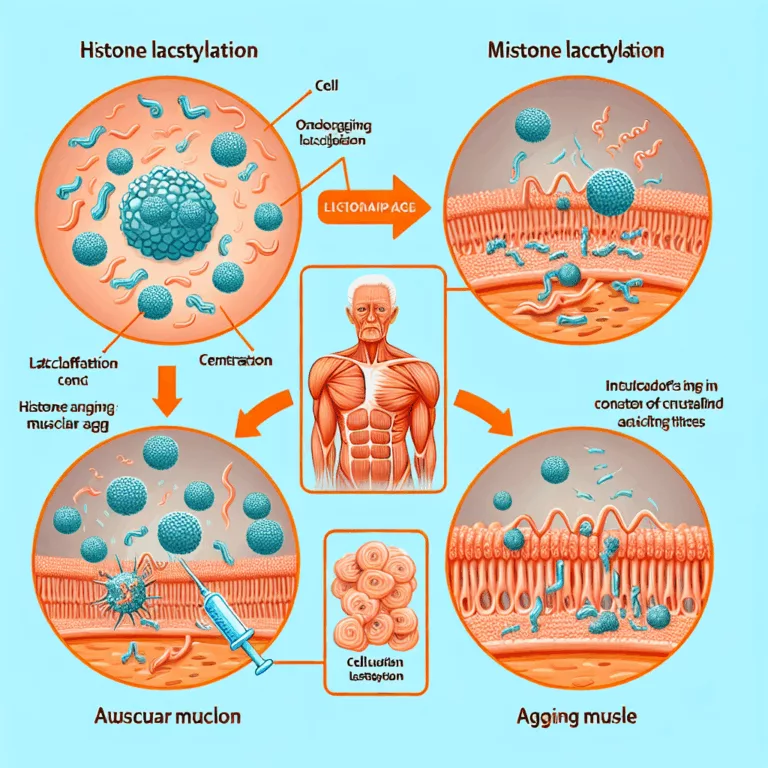Les avancées révolutionnaires dans le traitement des maladies liées à l’âge : Une exploration des mécanismes de la longévité
Découvrez comment les dernières innovations médicales ciblent les mécanismes du vieillissement pour améliorer la longévité et la santé des personnes âgées.