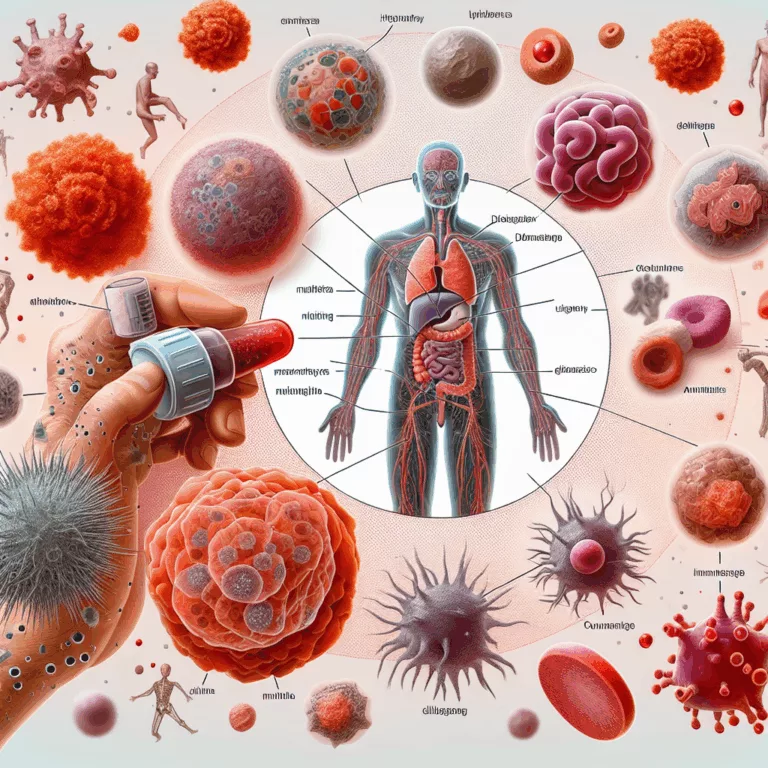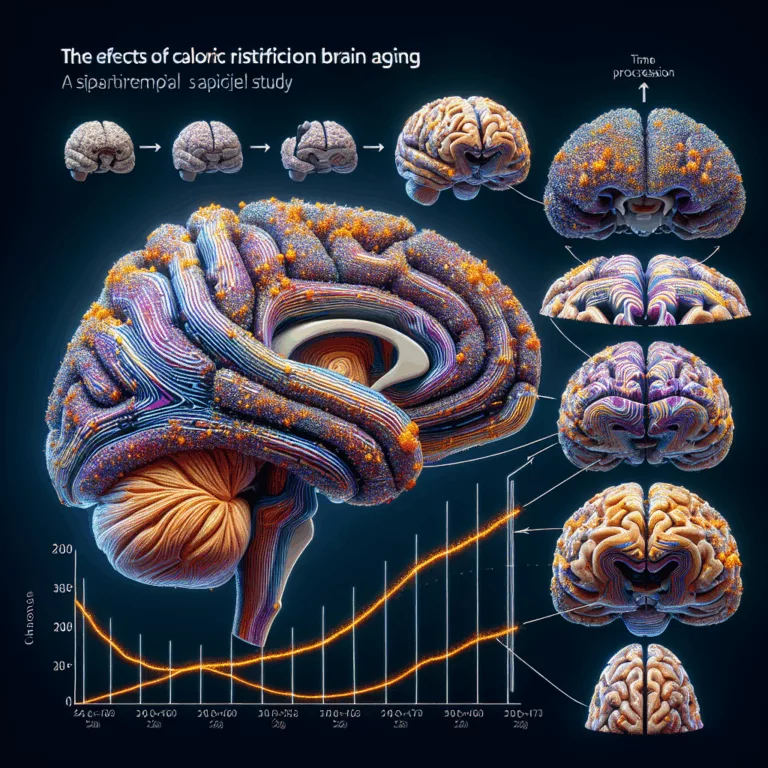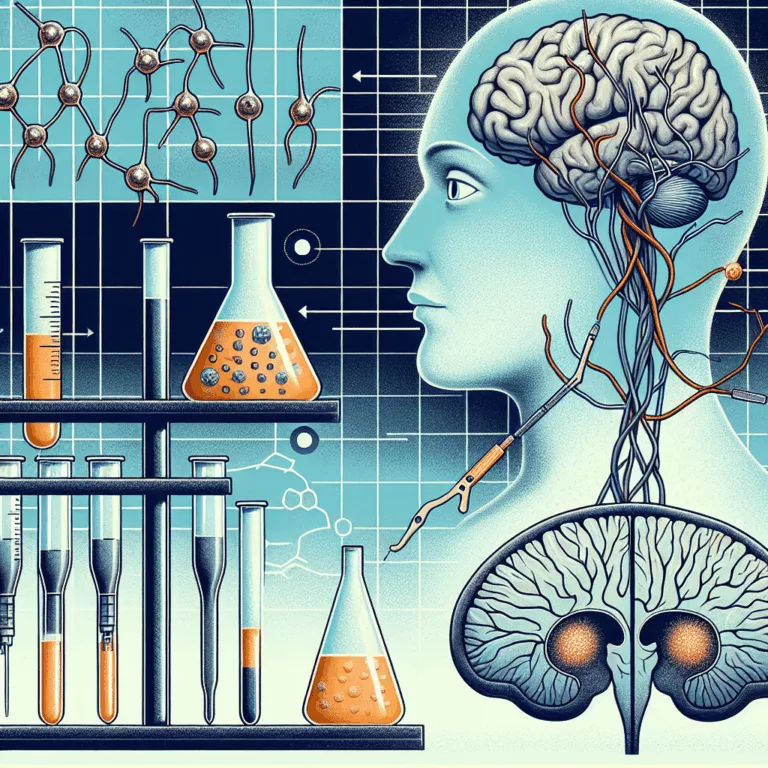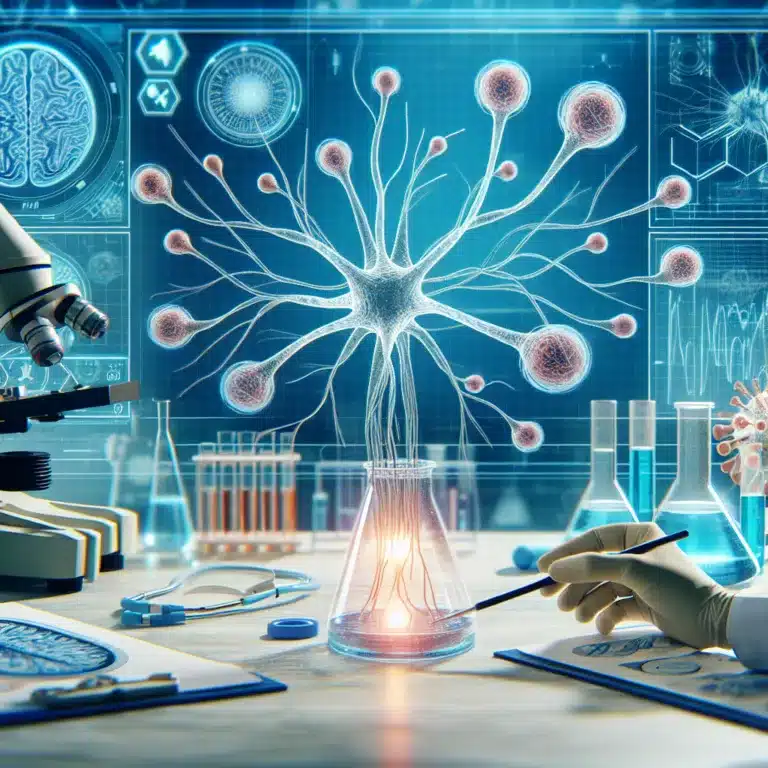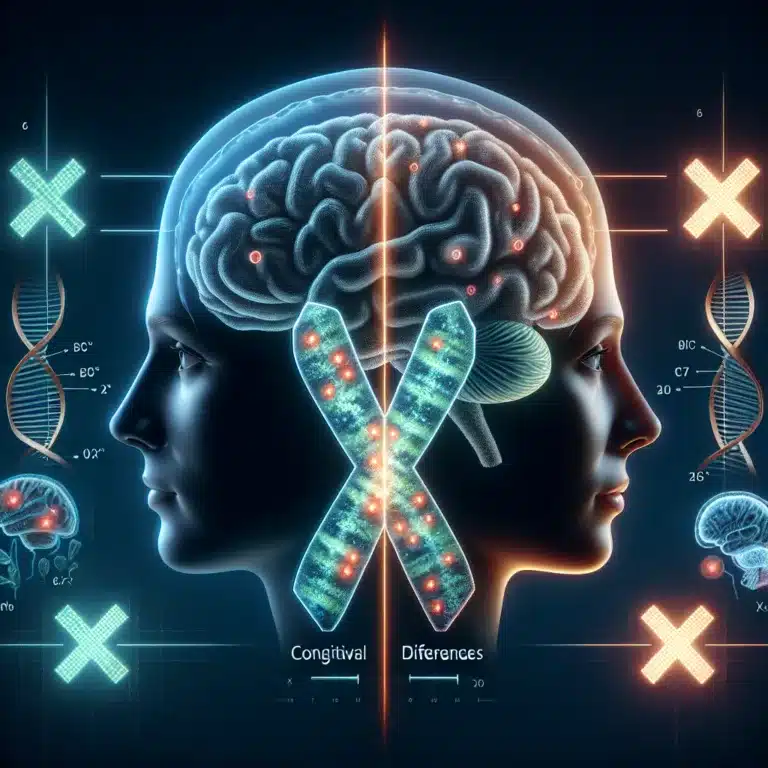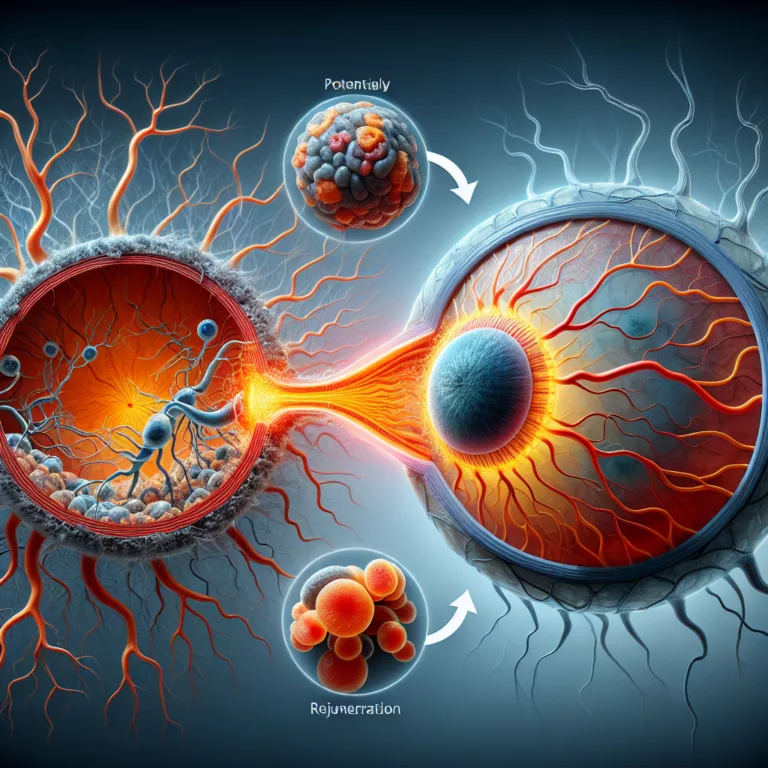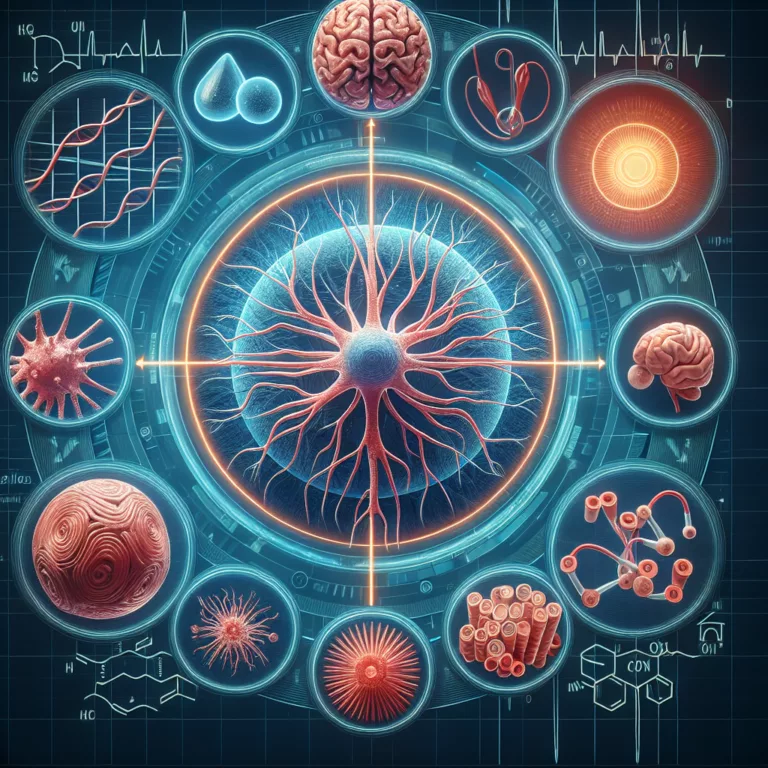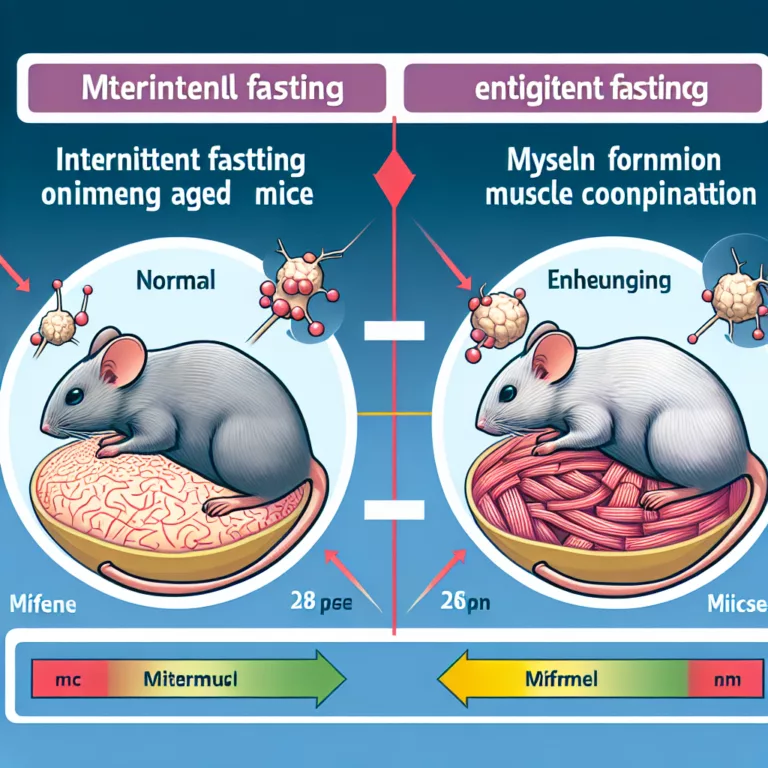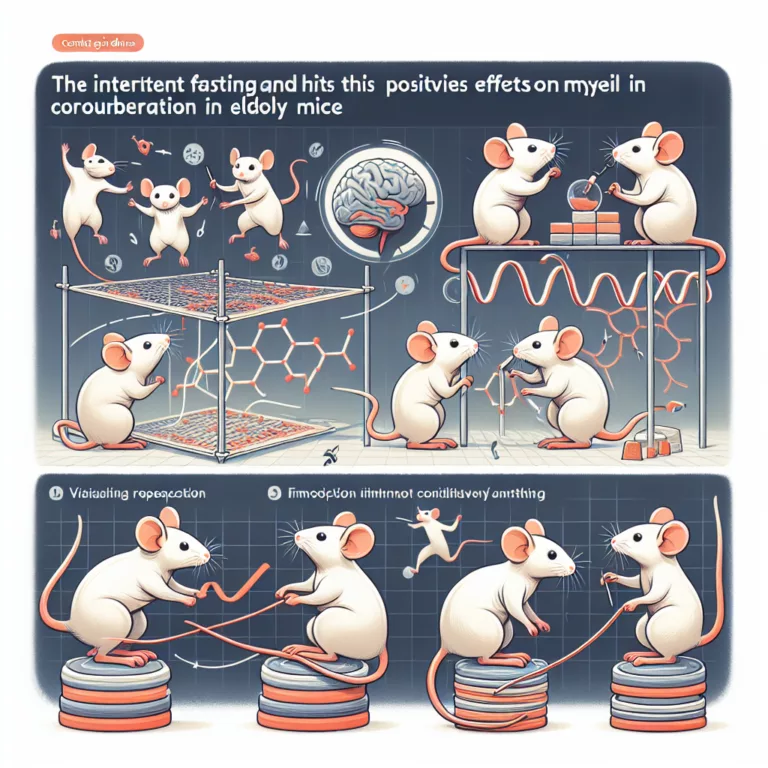Caractérisation des sous-types de macrophages et leur impact sur le vieillissement et l’obésité
Découvrez comment les sous-types de macrophages influencent le vieillissement et l’obésité, révélant des liens surprenants entre inflammation et régénération.