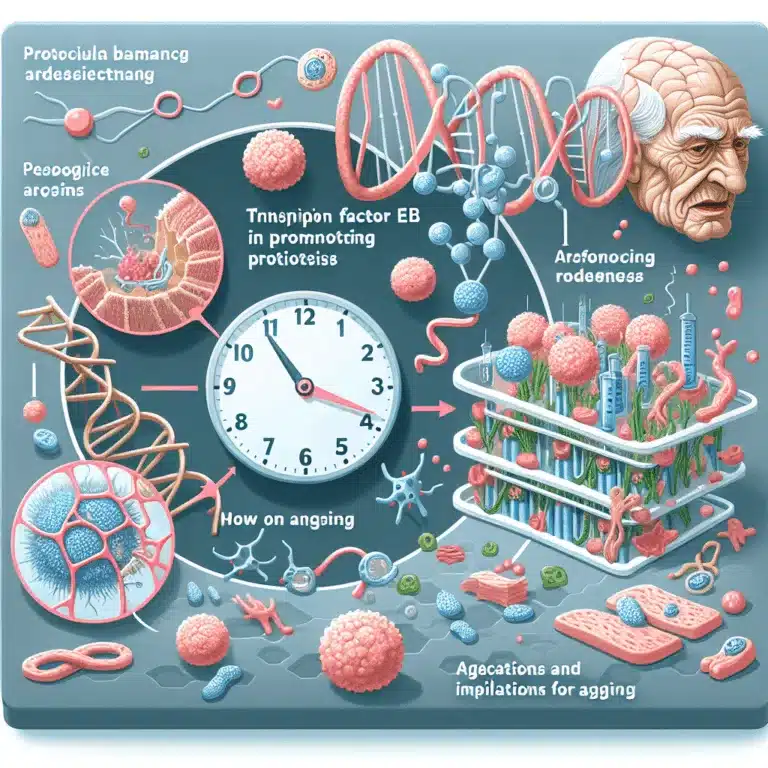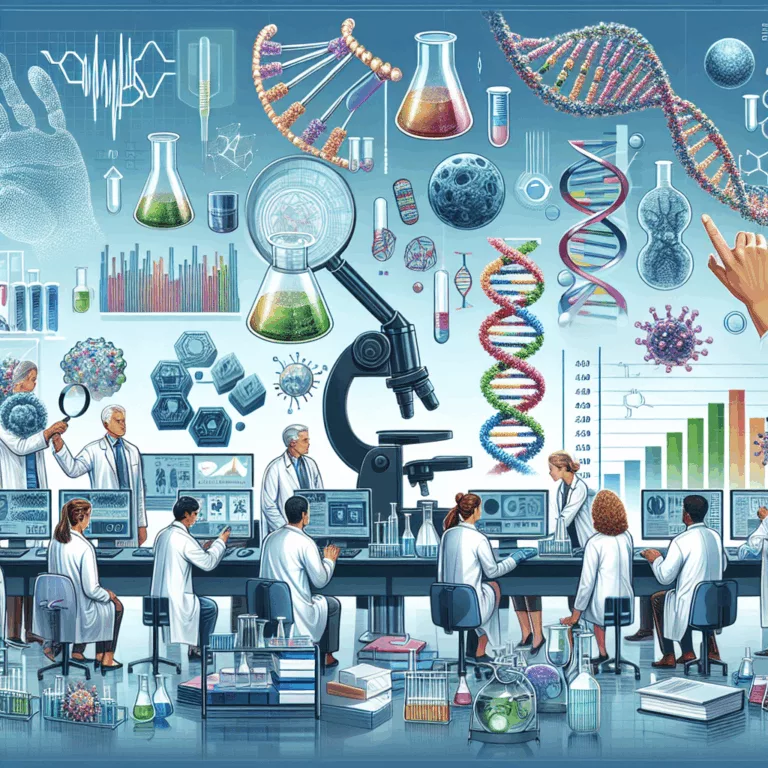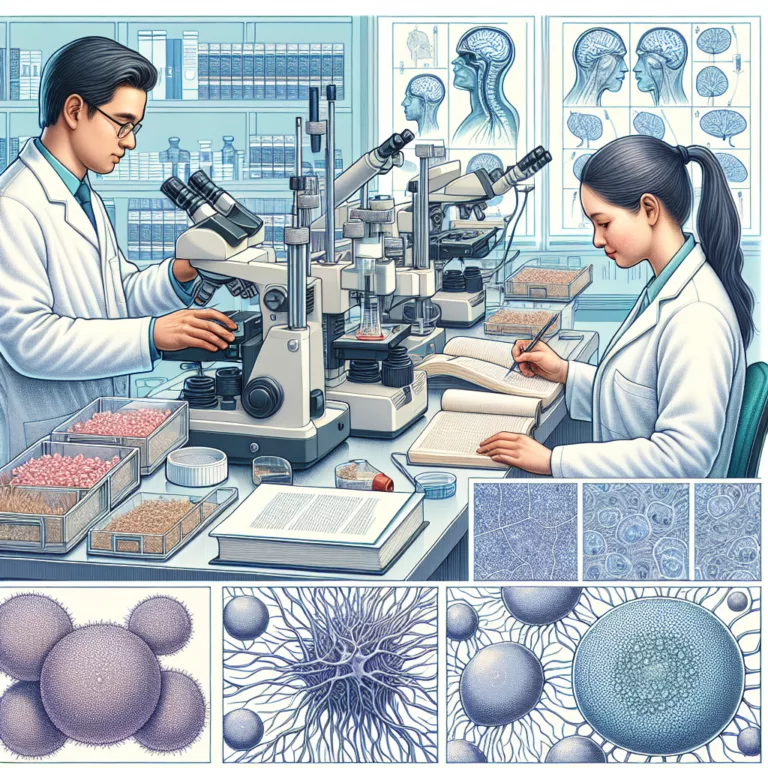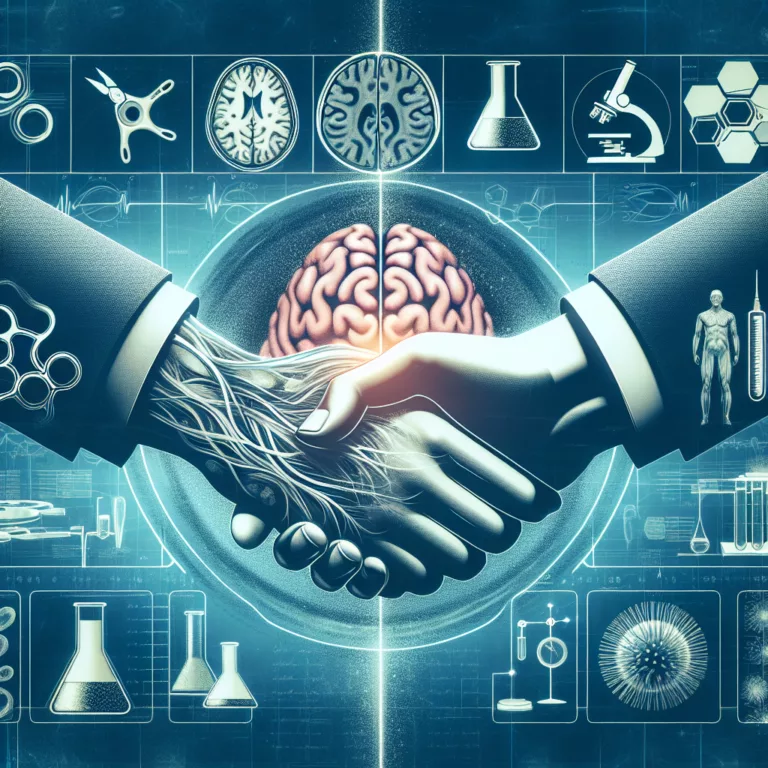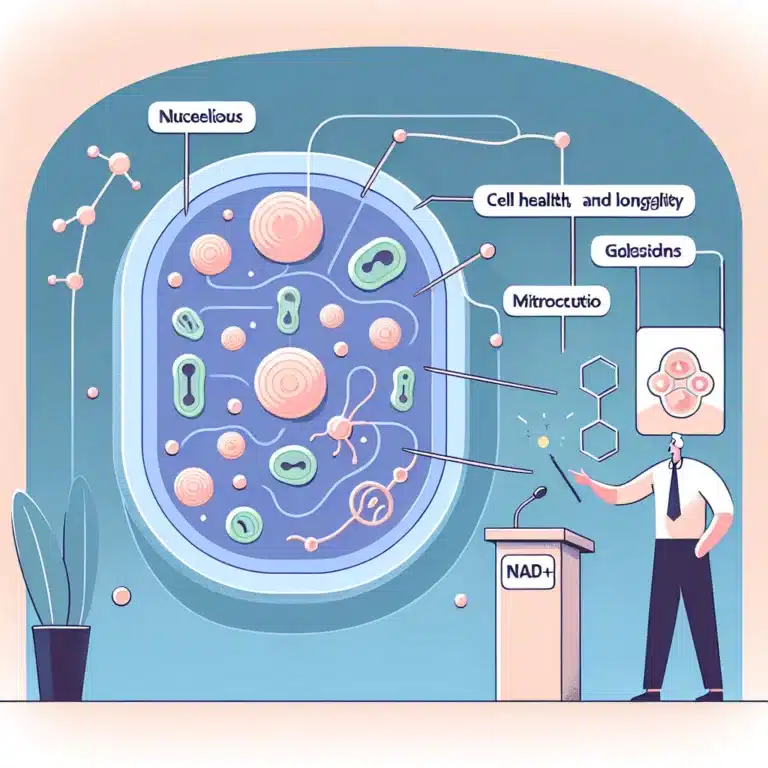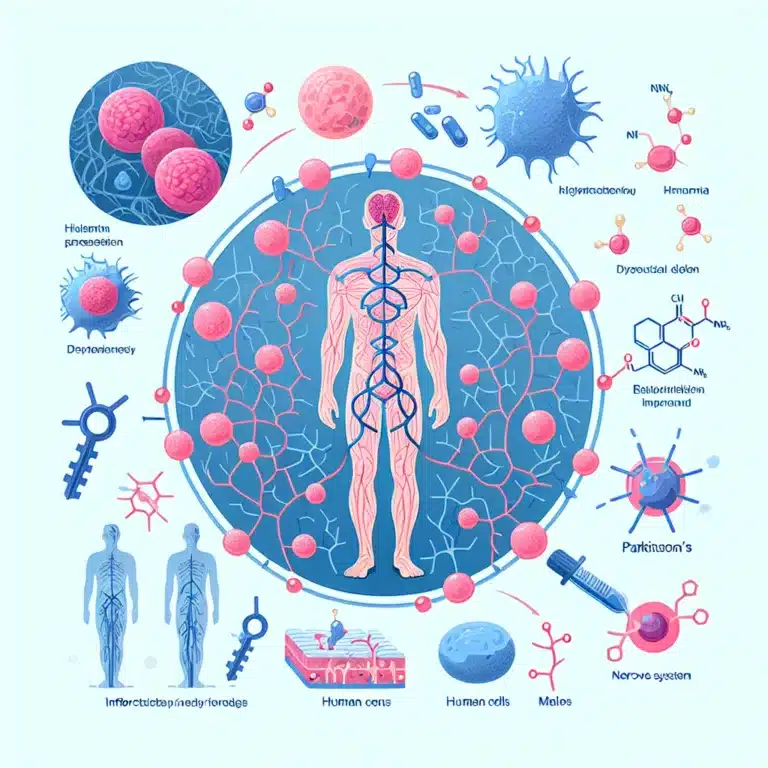Le rôle du facteur de transcription EB (TFEB) dans la promotion de la protéostasie et ses implications pour le vieillissement
Dans une étude publiée dans Aging Cell, des chercheurs ont examiné comment le facteur de transcription EB (TFEB) favorise la protéostasie dans un modèle de vieillissement commun. La protéostasie, essentielle pour le bon fonctionnement des protéines, est maintenue par un système de contrôle qualité qui utilise un réseau de chaperons et co-chaperons, responsables du repliement,…