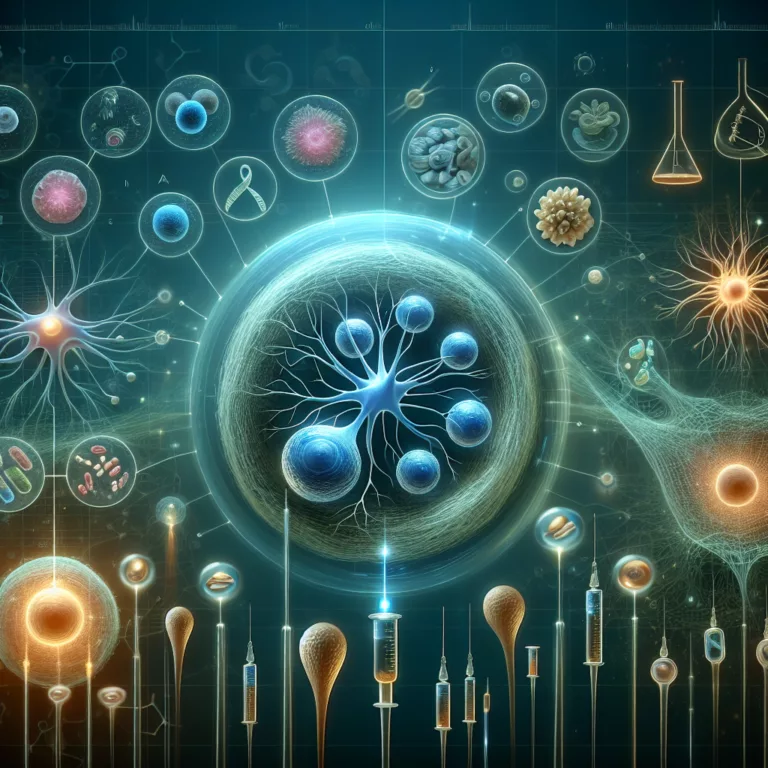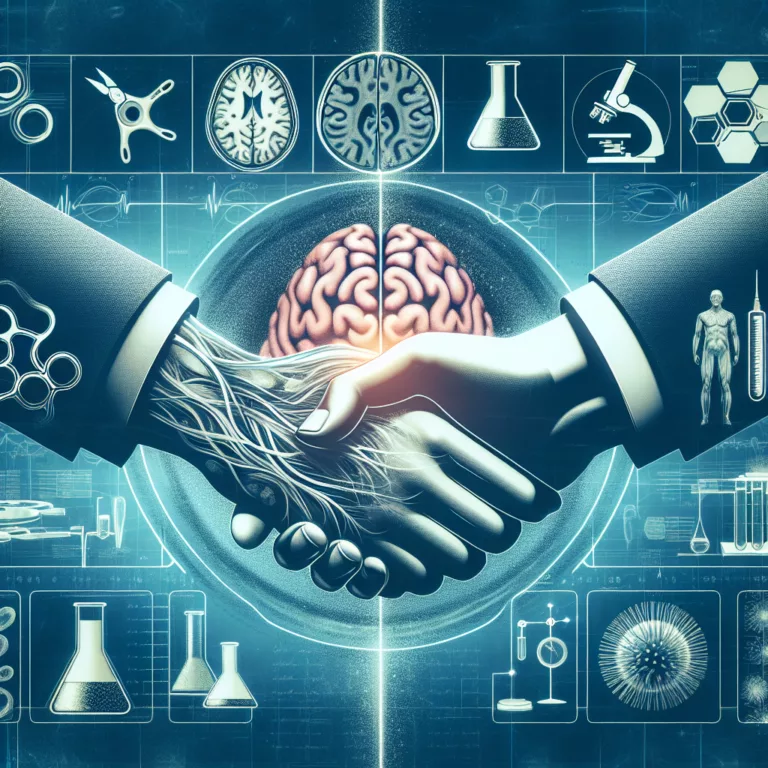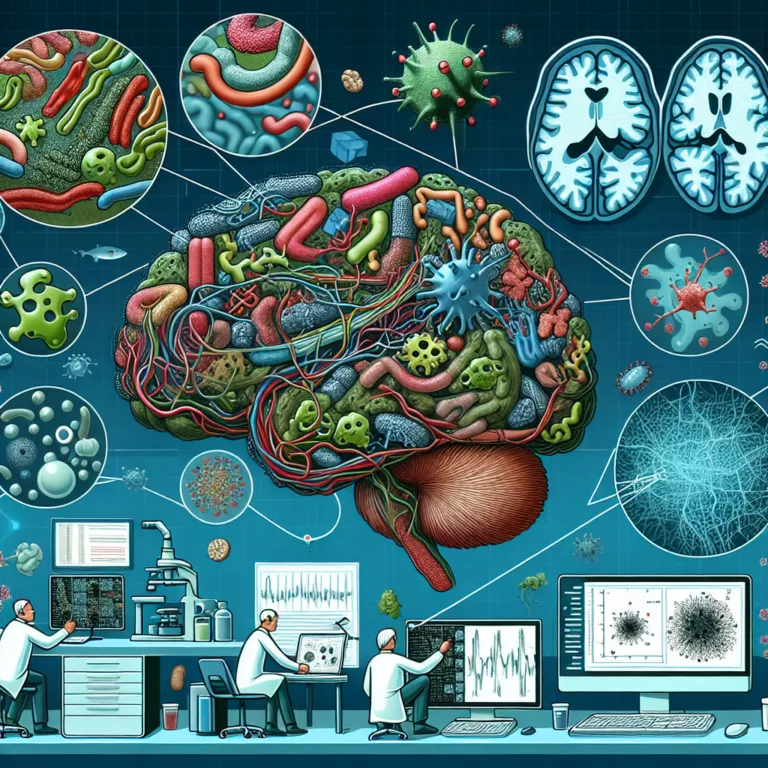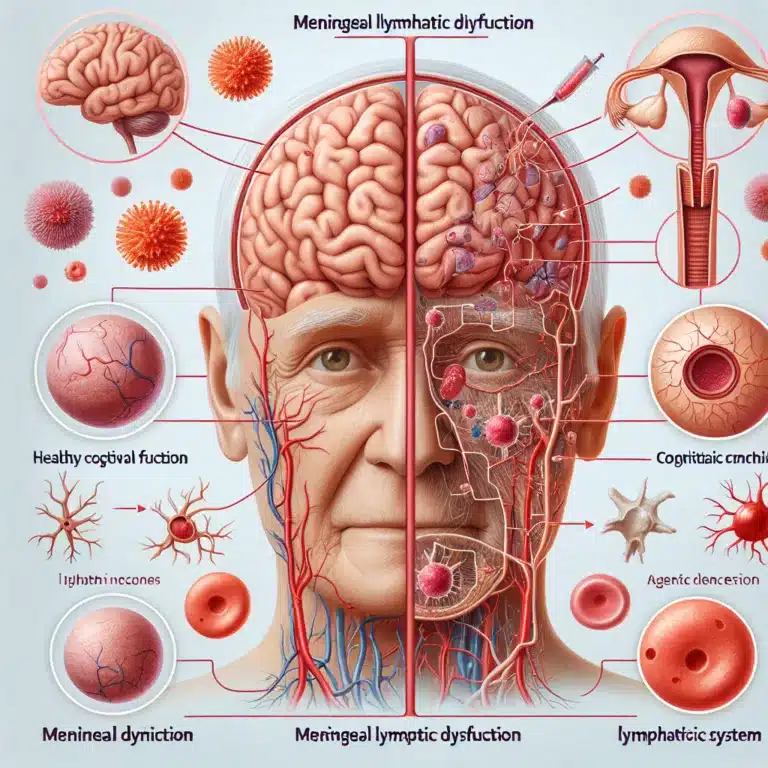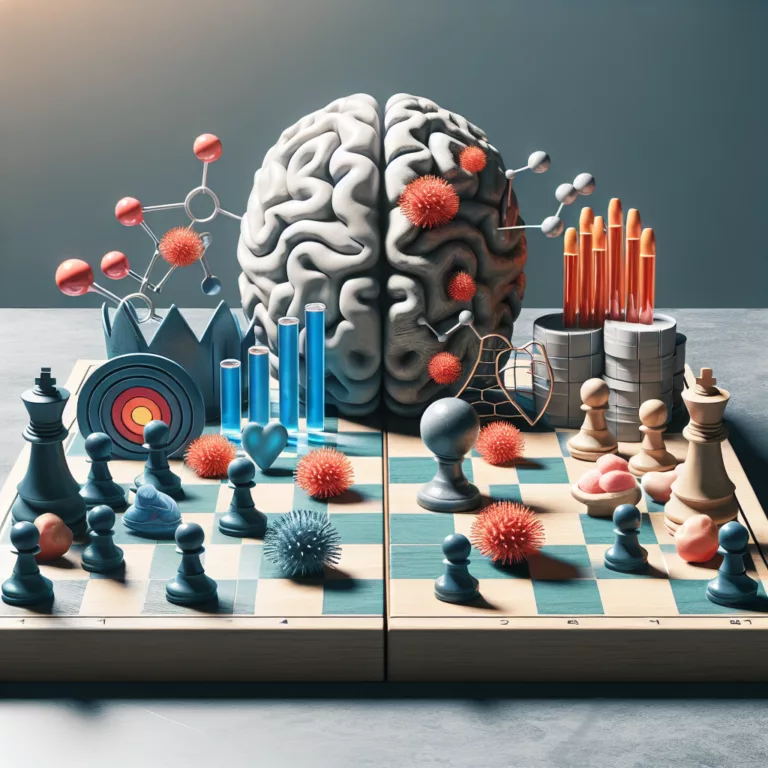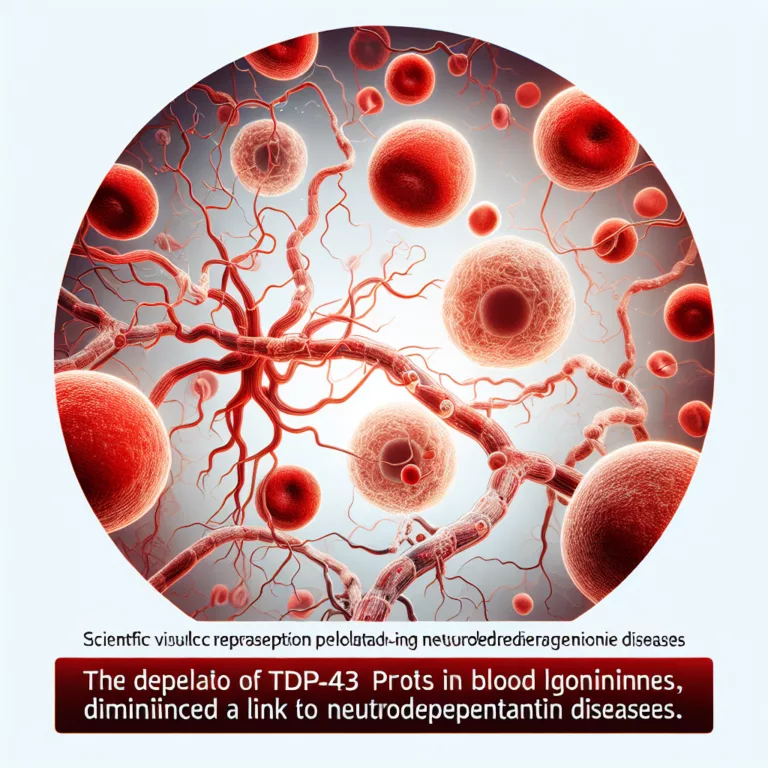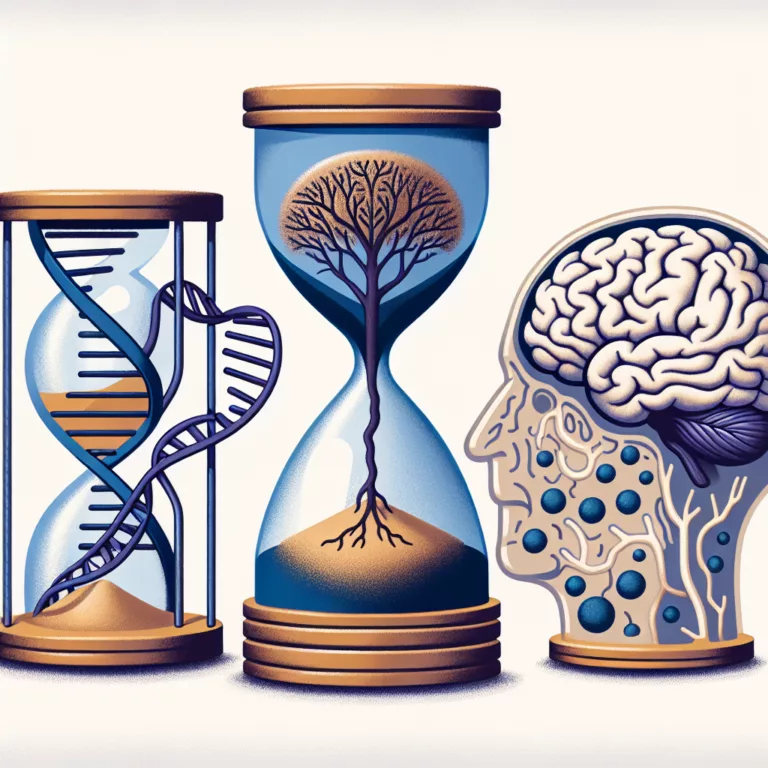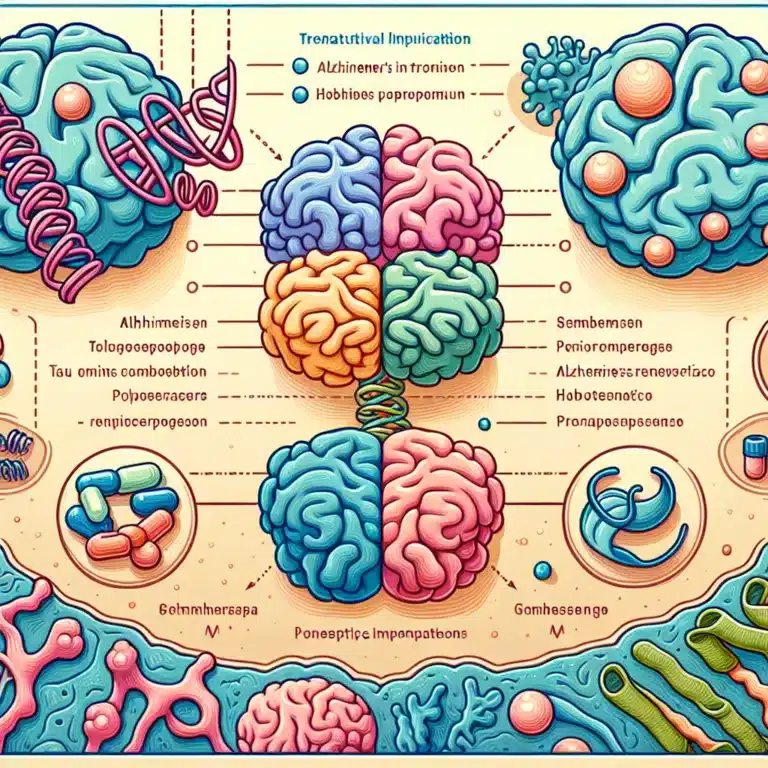La neurogenèse : processus, enjeux et perspectives thérapeutiques
La neurogenèse est le processus par lequel de nouveaux neurones sont formés à partir de populations de cellules souches neurales. Ce processus est crucial pour la mémoire, l’apprentissage, le maintien normal des tissus cérébraux et la régénération partielle après une blessure. Avec l’âge, la neurogenèse diminue, ce qui contribue à la perte de fonctions cognitives…