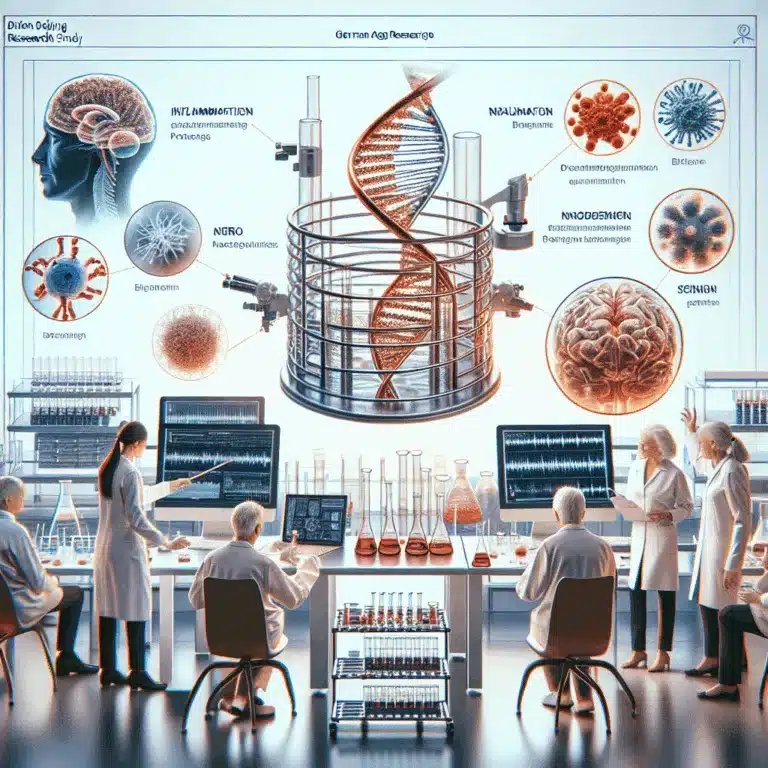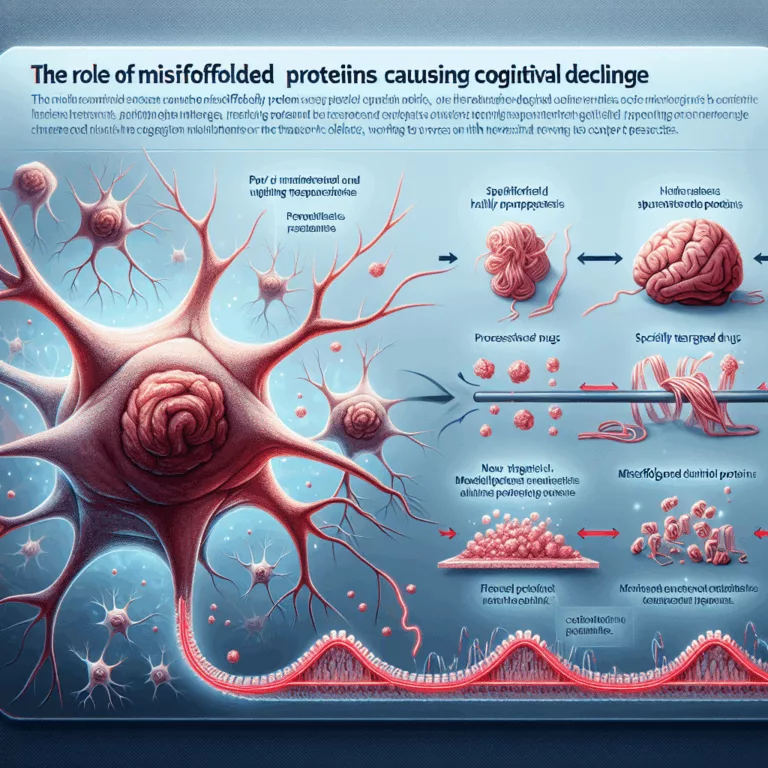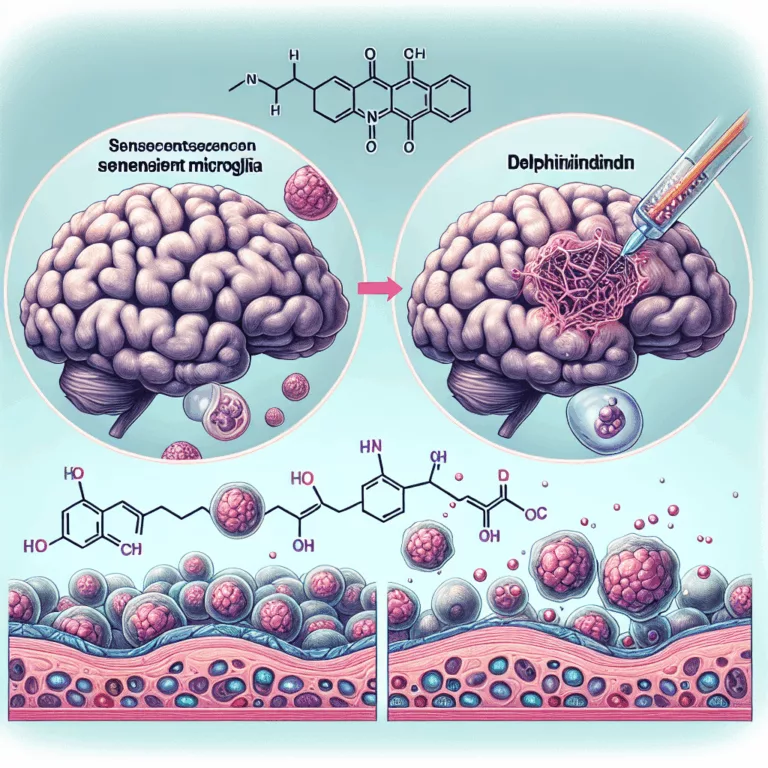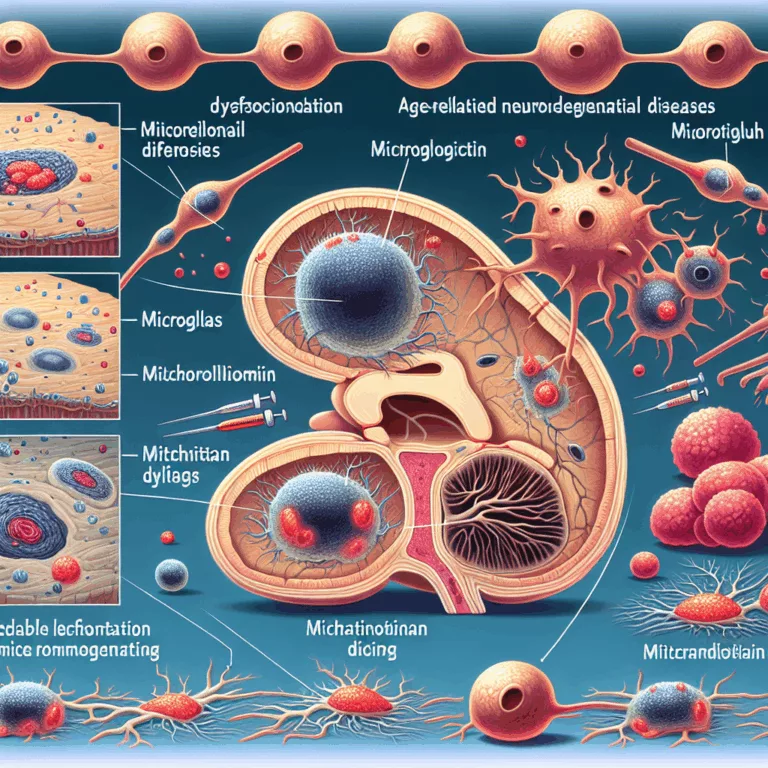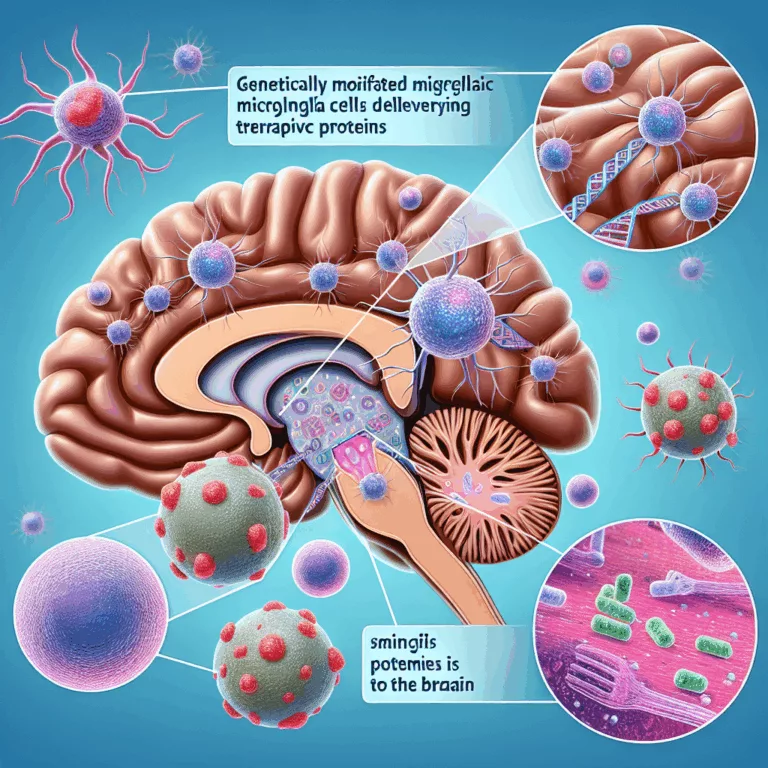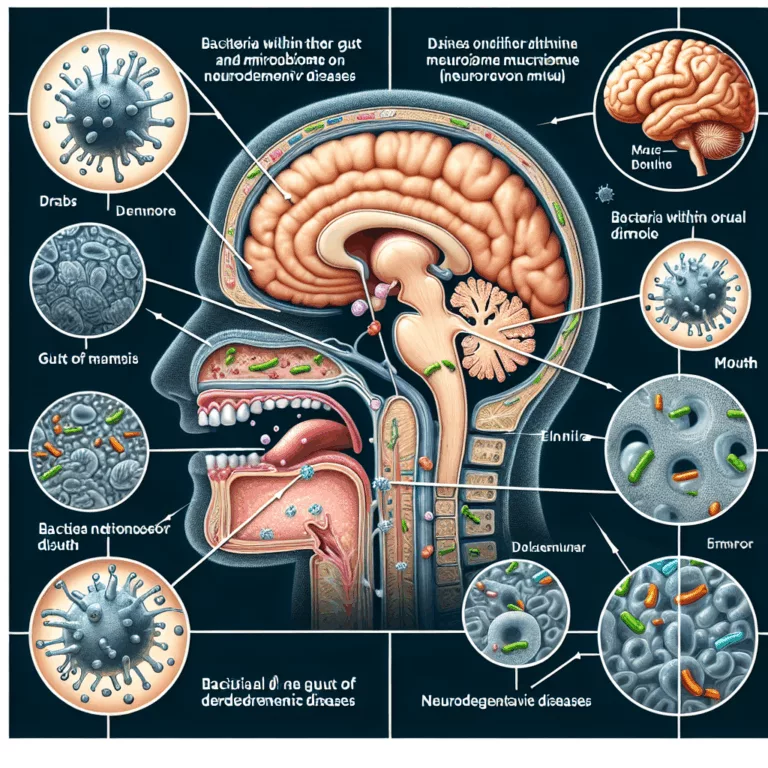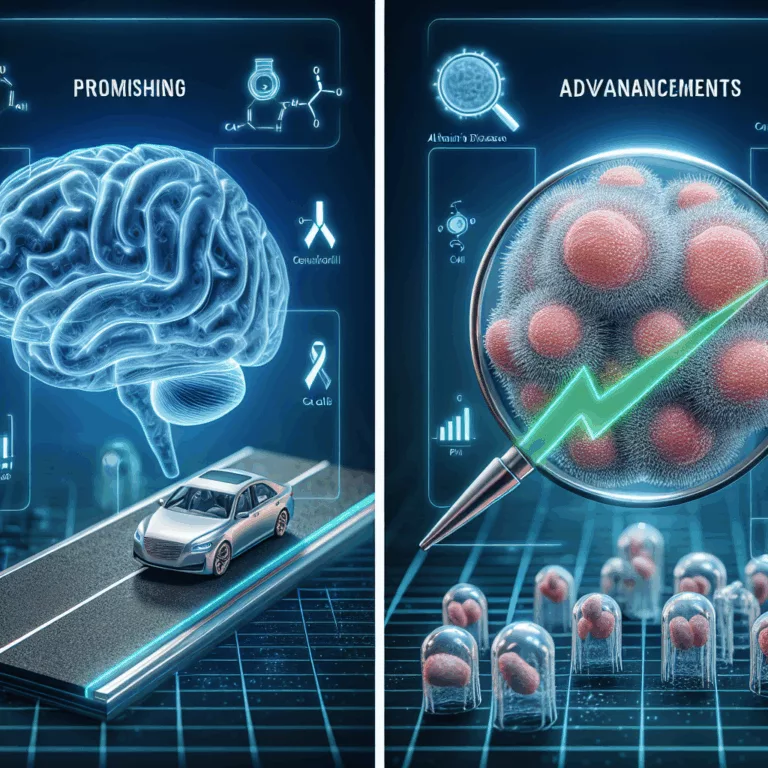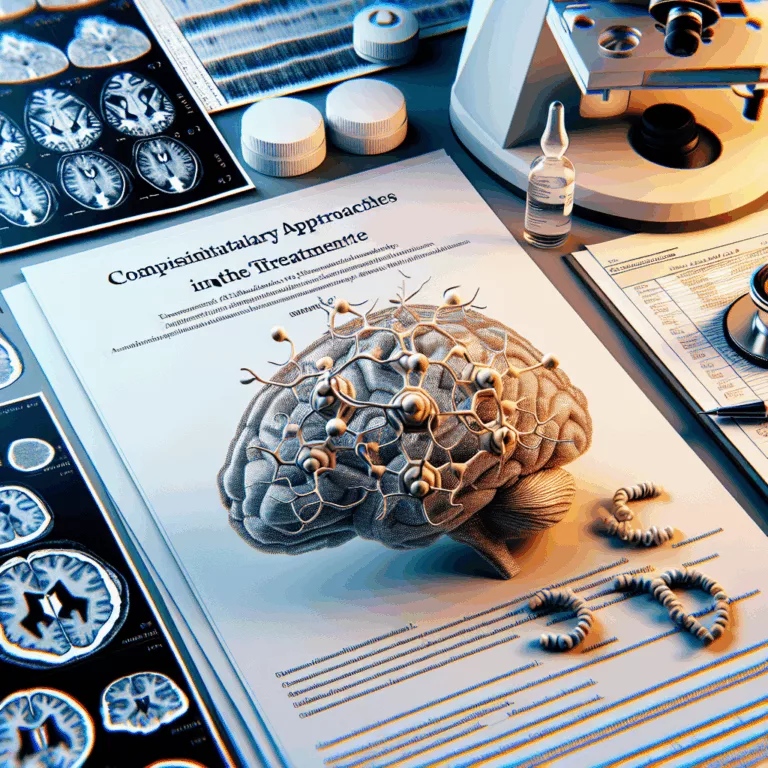Lutter contre le Vieillissement : Avancées Scientifiques et Perspectives
Fight Aging! est une publication qui vise à mettre fin aux maladies liées à l’âge en utilisant les mécanismes de vieillissement sous le contrôle de la médecine moderne. Cette newsletter hebdomadaire est envoyée à des milliers d’abonnés intéressés. Le fondateur de Fight Aging!, Reason, propose également des services de conseil stratégique dans le secteur de…