Le rôle des macrophages sénescents dans l’évolution des tumeurs : un équilibre délicat
Découvrez comment les macrophages sénescents influencent la croissance tumorale et l’évasion immunitaire dans le microenvironnement tumoral.

Découvrez comment les macrophages sénescents influencent la croissance tumorale et l’évasion immunitaire dans le microenvironnement tumoral.
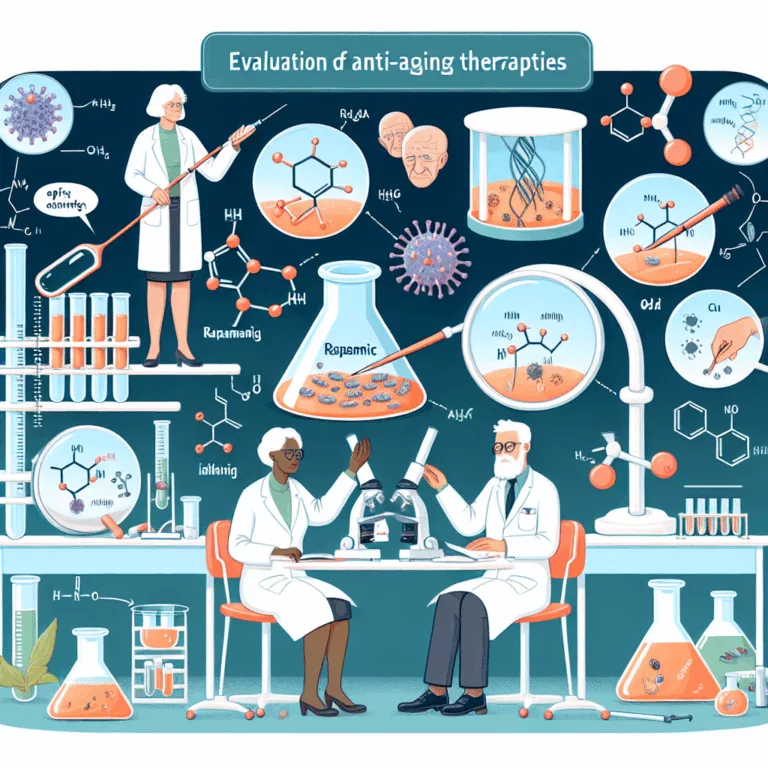
Le texte aborde les interventions disponibles pour traiter le vieillissement, en se concentrant sur les options ayant des preuves humaines significatives pour la sécurité et des données animales robustes pour l’efficacité. Les interventions mentionnées incluent la restriction calorique (guide du jeûne et de la restriction calorique), l’exercice, le rapamycine et les traitements sénolytiques, en particulier…

La régulation des médicaments au sein des institutions académiques et gouvernementales est dominée par une vision qui considère que les individus ne devraient pas avoir le droit de choisir leurs propres risques ni de commettre leurs propres erreurs. Cette approche préconise que le rôle des régulateurs est d’éliminer autant de risques que possible. Les coûts…
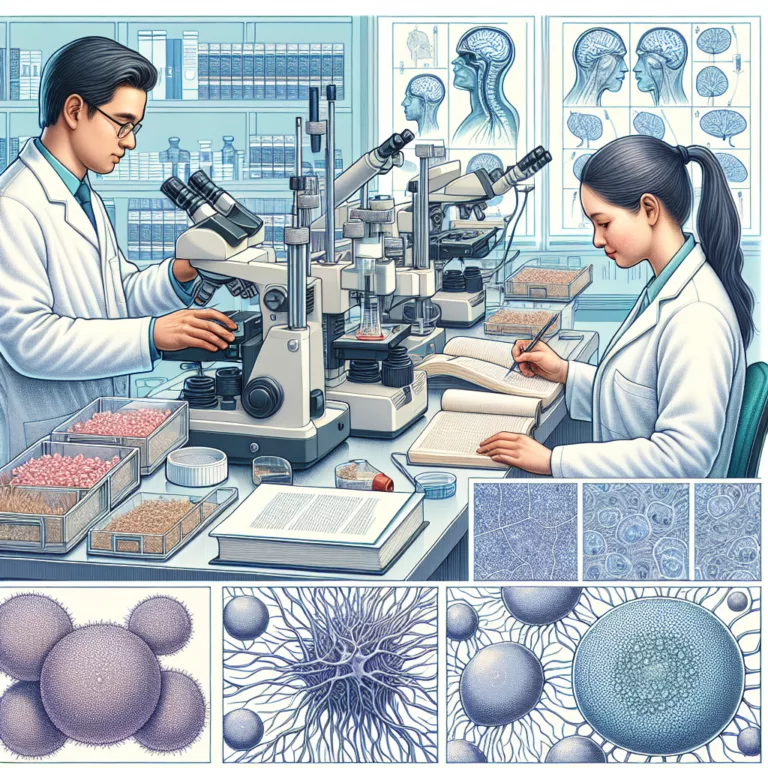
Dans une avancée significative pour les traitements des maladies neurodégénératives, des chercheurs australiens ont développé des greffes neuronales non immunogènes en utilisant des cellules souches induites pluripotentes (iPSCs) reprogrammées. Ces cellules, capables de se différencier en neurones, ont été génétiquement modifiées pour surexprimer huit gènes qui permettent à certaines cellules, comme celles du placenta ou…

LyGenesis, une biotech en phase clinique spécialisée dans la régénération des organes, a obtenu l’approbation de son Data and Safety Monitoring Board (DSMB) pour poursuivre et augmenter les doses dans son essai clinique de phase 2a. Cet essai évalue une approche novatrice pour la régénération d’organes, en particulier pour les patients atteints de maladie hépatique…