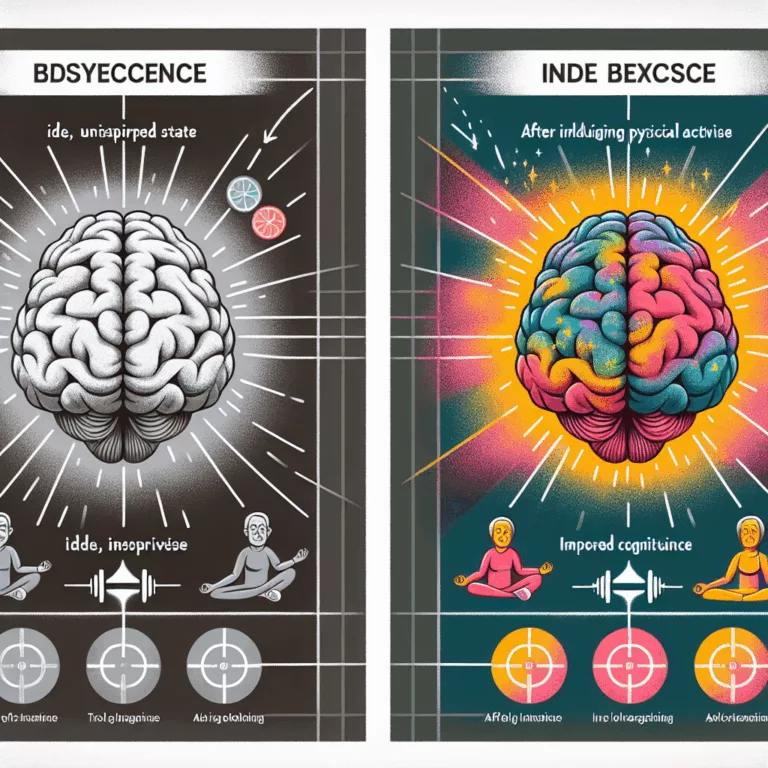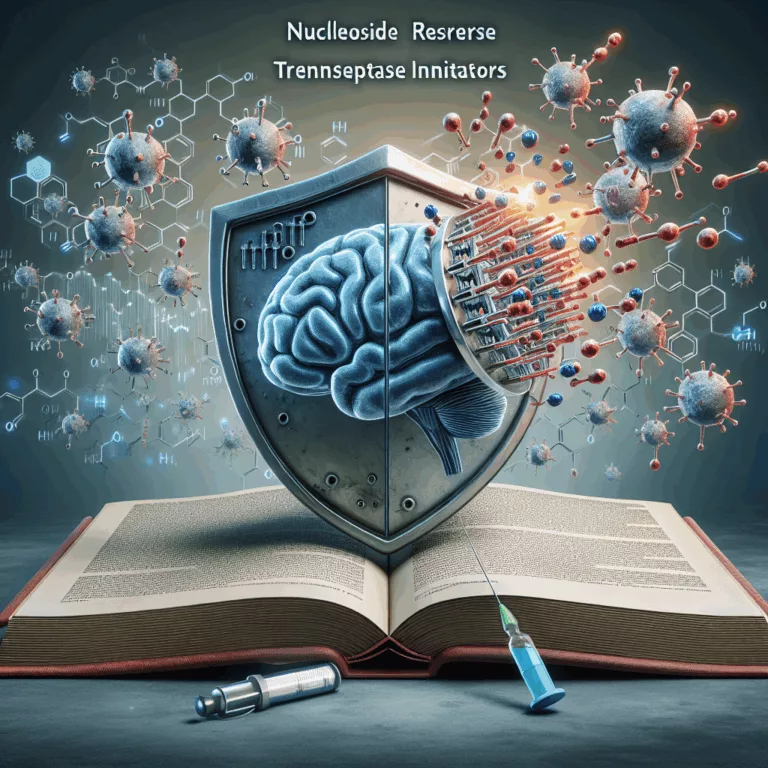L’impact de la bière sur le vieillissement et la santé : Une étude sur des souris
Des scientifiques ont mené des recherches sur l’impact de trois types de bière sur des souris mâles vieillies artificiellement, enregistrant divers effets bénéfiques, tels que des améliorations de la diversité du microbiome et des profils lipidiques. Bien qu’il soit clairement établi que la consommation excessive d’alcool nuit à la santé, le débat autour de la…