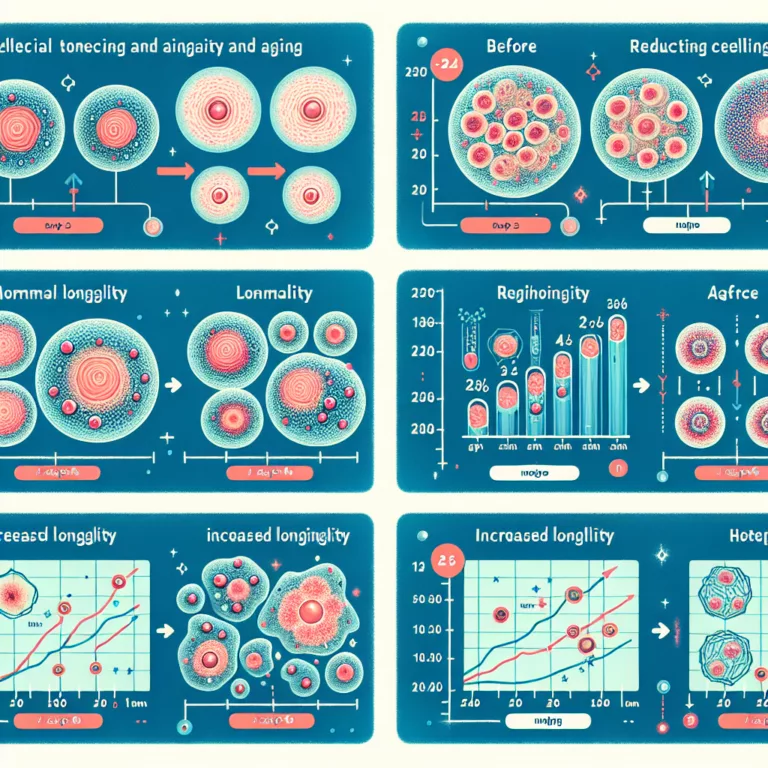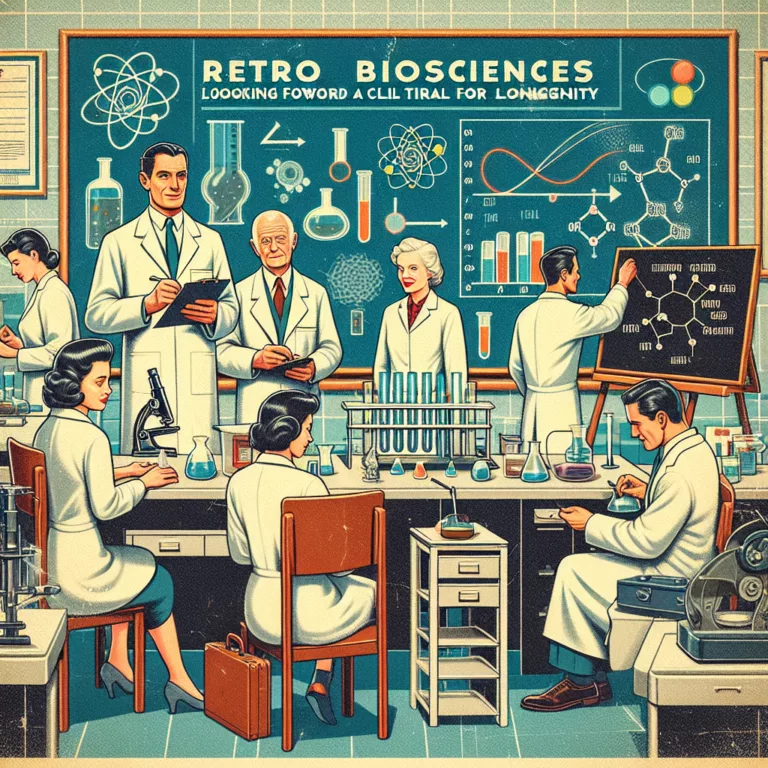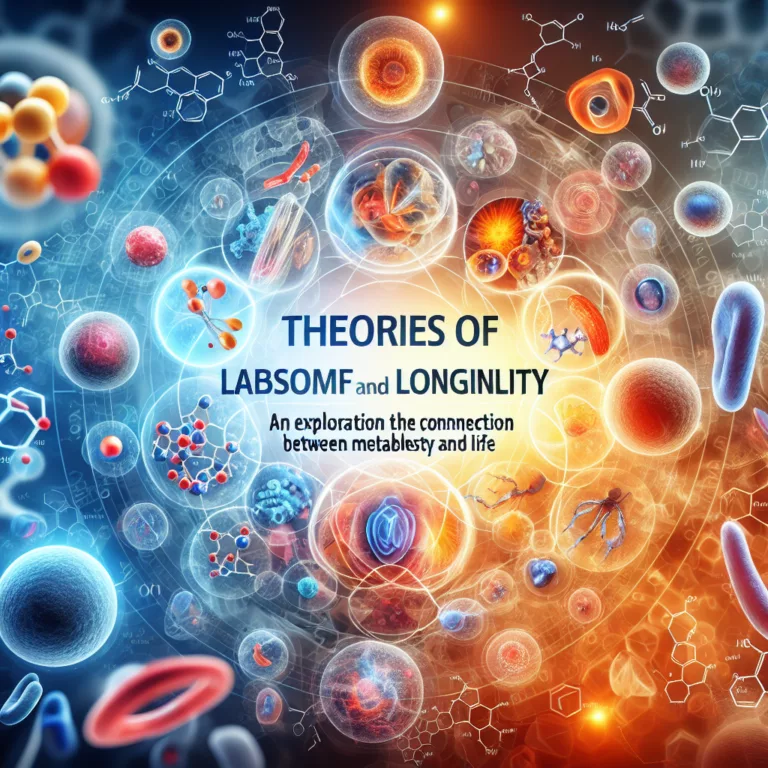Impact de la réduction de TOP2B sur la longévité et le vieillissement cellulaire
Les mécanismes épigénétiques jouent un rôle crucial dans la détermination de la structure de l’ADN nucléaire, notamment par le biais de modifications chimiques spécifiques qui se fixent à des endroits précis du génome ou des molécules d’histones. Cette structure influence la manière dont les protéines sont produites, impactant ainsi le comportement cellulaire. Dans cette étude,…