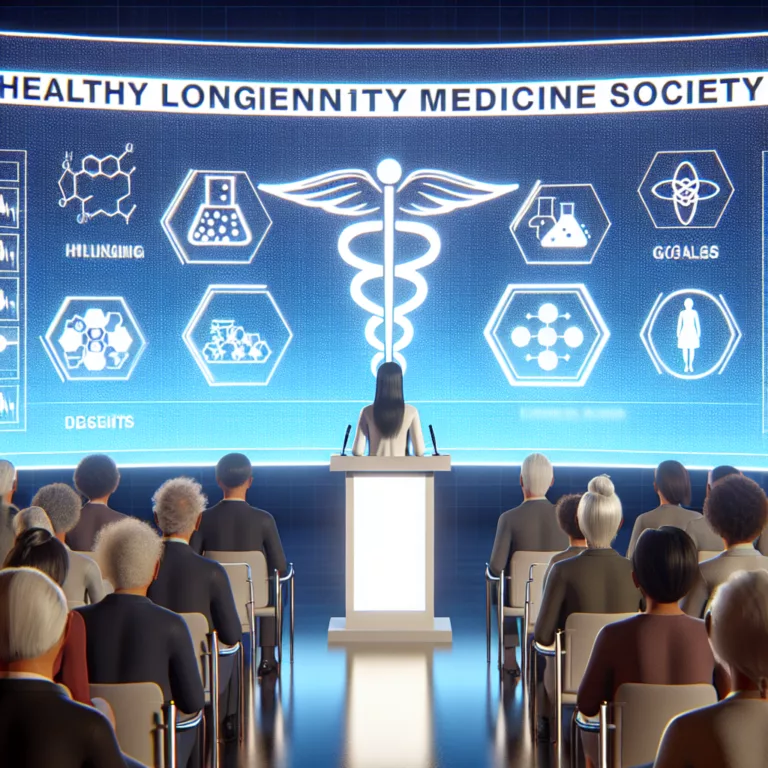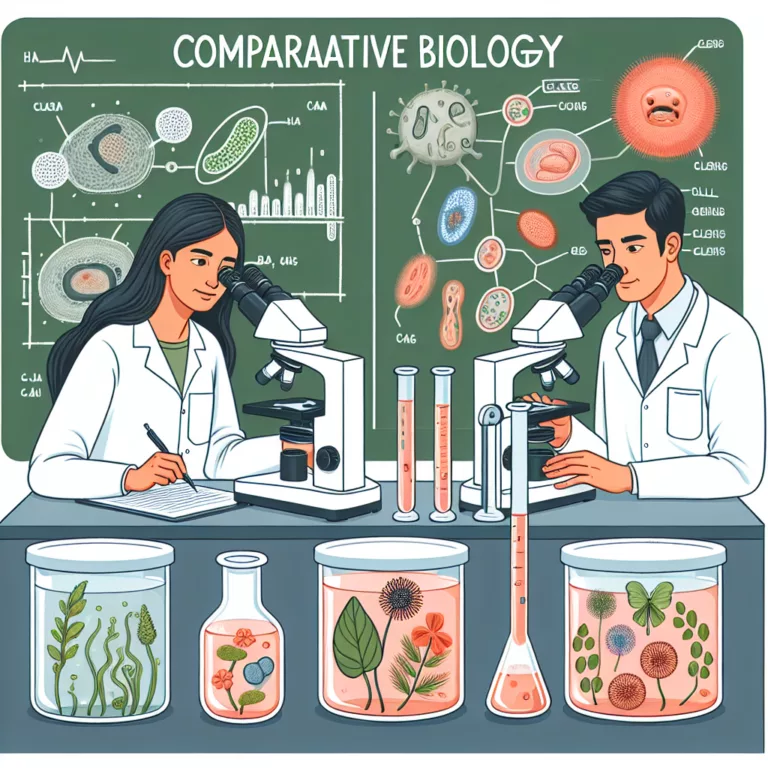Les biomarqueurs du vieillissement : Défis et promesses pour une application clinique
Les biomarqueurs du vieillissement représentent une avancée prometteuse dans la recherche sur le vieillissement, permettant d’estimer non seulement l’âge chronologique d’un individu à partir d’un simple échantillon de sang, mais aussi la manière dont son corps a résisté au passage du temps. Bien que ces biomarqueurs, issus de l’analyse de protéines, de motifs de méthylation…