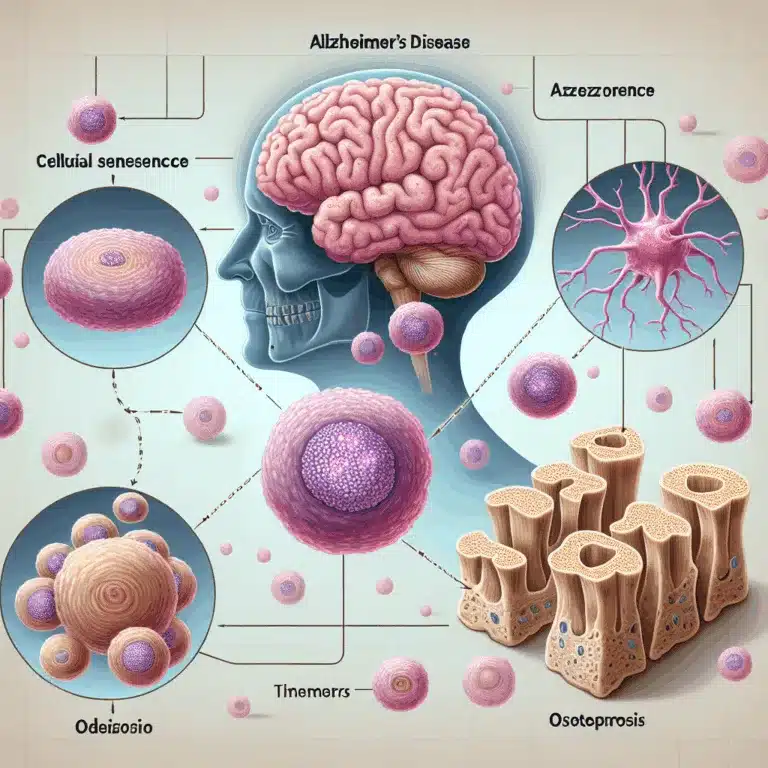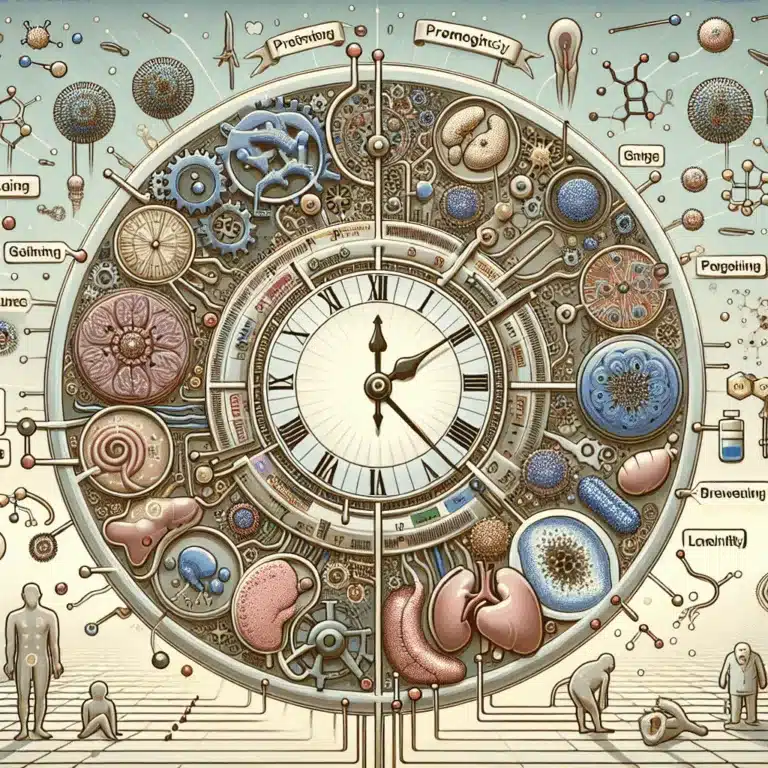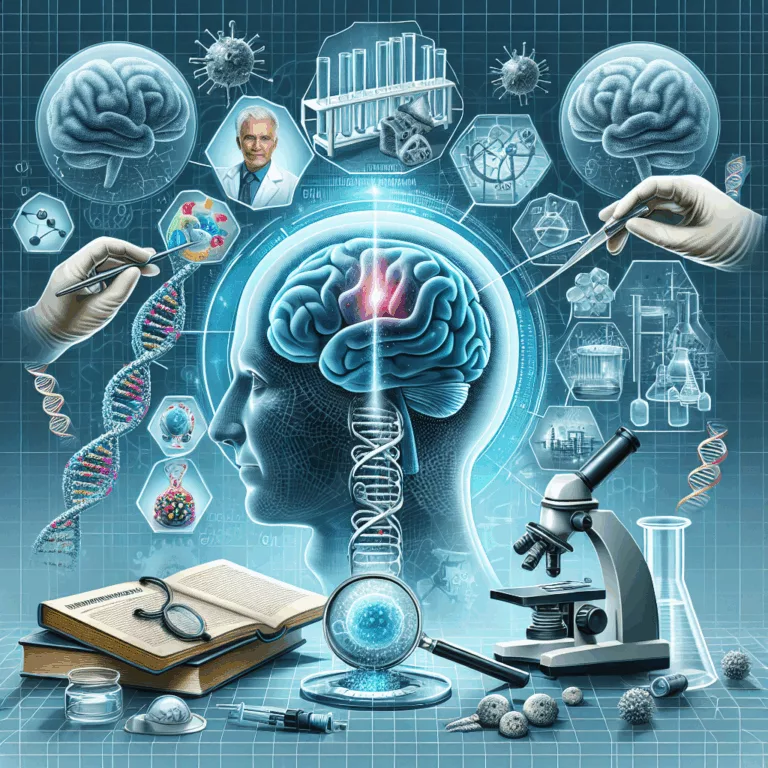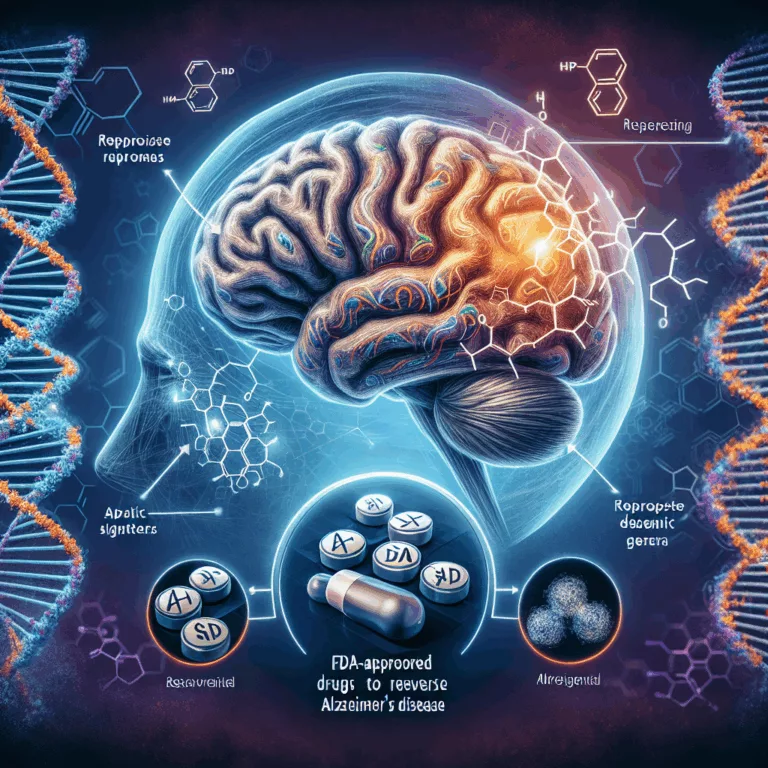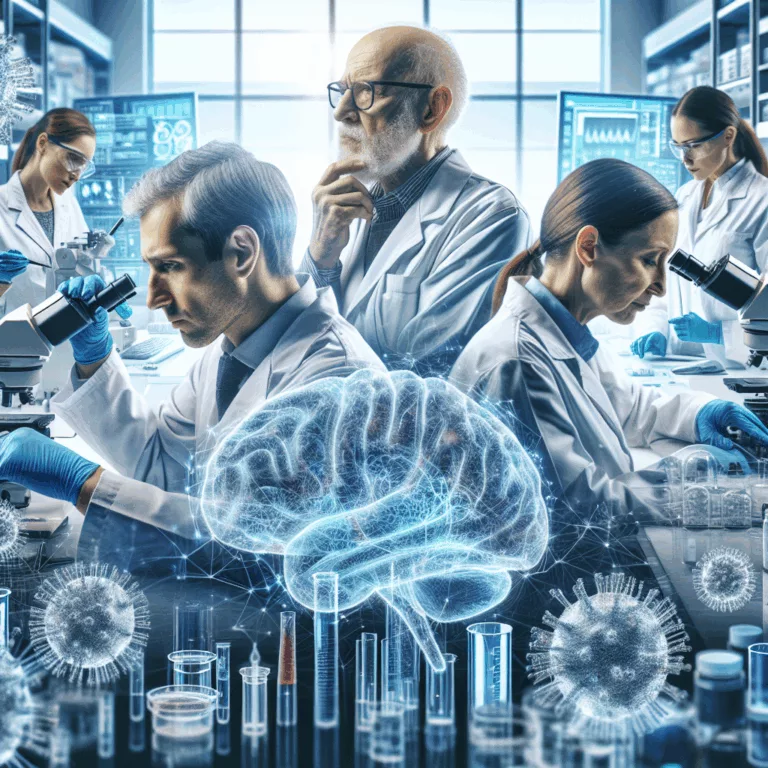L’inefficacité des traitements antiviraux contre l’Alzheimer en lien avec les infections herpétiques
Les preuves concernant l’infection virale persistante, notamment par les virus de l’herpès, comme cause significative de la maladie d’Alzheimer, sont mitigées et souvent contradictoires. Bien qu’il existe des mécanismes clairs par lesquels une infection persistante pourrait contribuer à la neurodégénérescence, seules certaines données épidémiologiques semblent appuyer le rôle d’une infection virale dans la maladie d’Alzheimer….