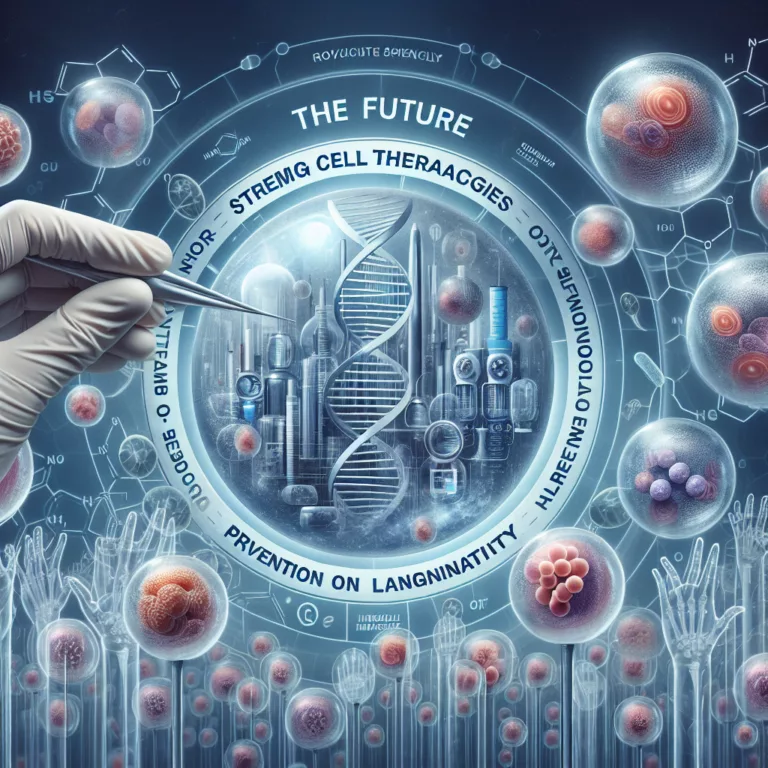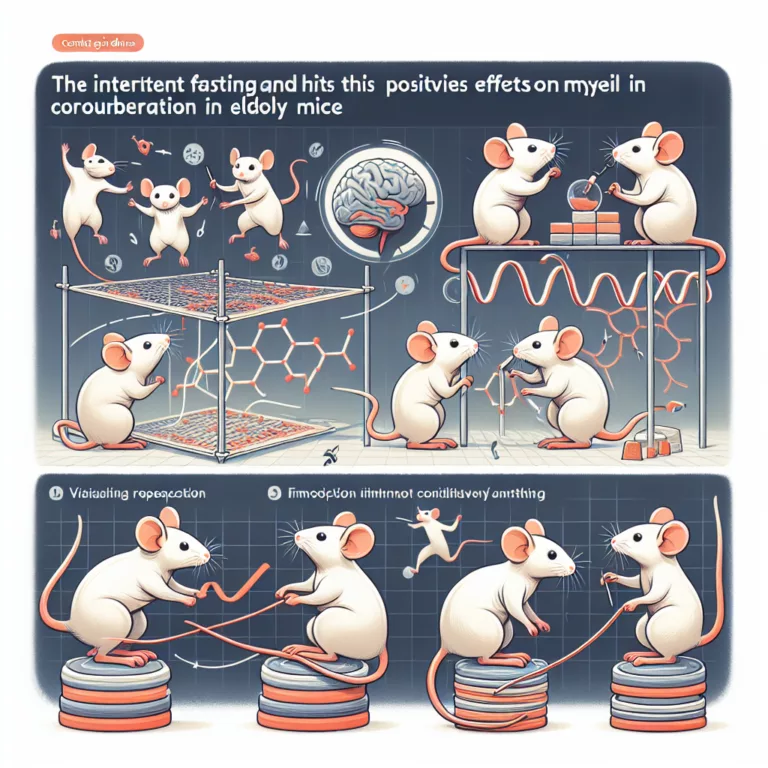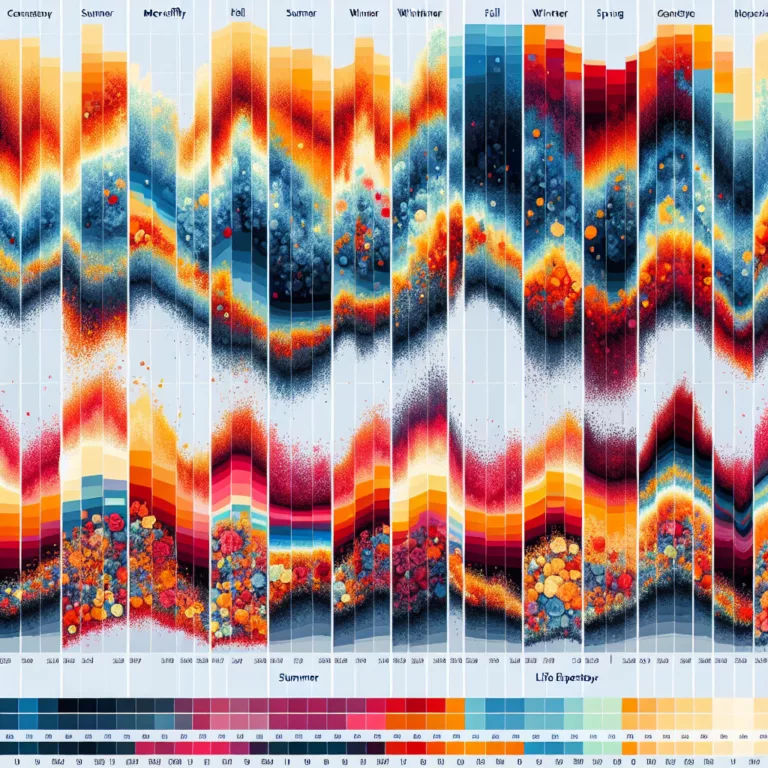Tune Therapeutics : Une avancée majeure dans l’édition épigénétique pour traiter les maladies chroniques
La société Tune Therapeutics, spécialisée dans l’édition de l’épigénome, a levé plus de 175 millions de dollars lors d’un financement de série B pour faire progresser sa plateforme de ‘réglage génétique’ et ses programmes thérapeutiques associés. Fondée en 2021, l’entreprise se concentre sur l’activation, le silence et l’ajustement précis de l’activité de gènes spécifiques afin…