Les acides aminés modifiés : un nouvel éclairage sur le vieillissement canin
Découvrez comment les acides aminés modifiés aident à comprendre le vieillissement des chiens et leur impact sur la santé humaine.
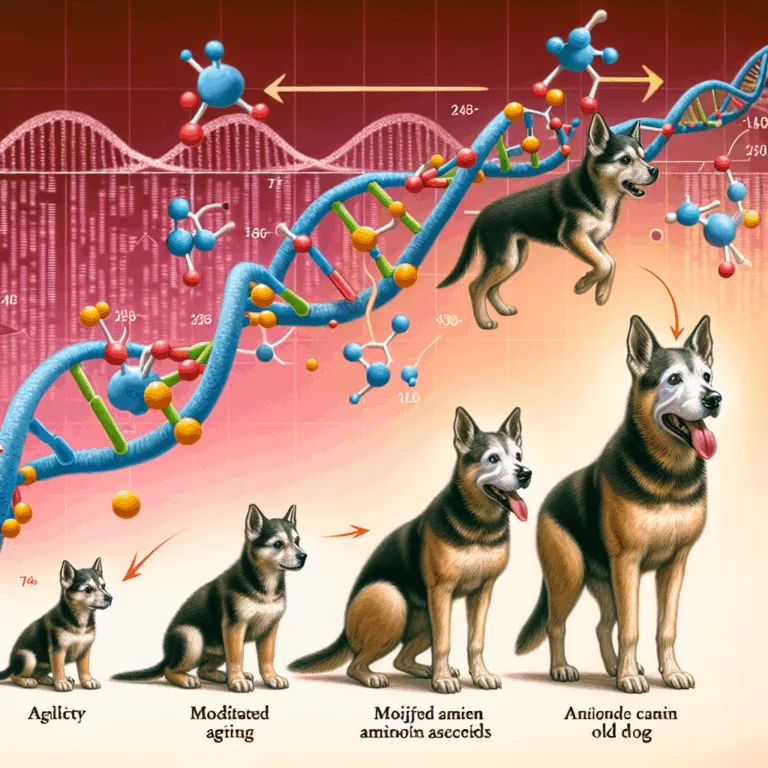
Découvrez comment les acides aminés modifiés aident à comprendre le vieillissement des chiens et leur impact sur la santé humaine.

Découvrez comment les exosomes issus de cellules souches révolutionnent le tourisme médical et leurs applications dans diverses pathologies.

Découvrez comment le BDNF influence la fonction cognitive et son rôle potentiel dans le déclin cognitif des personnes âgées.
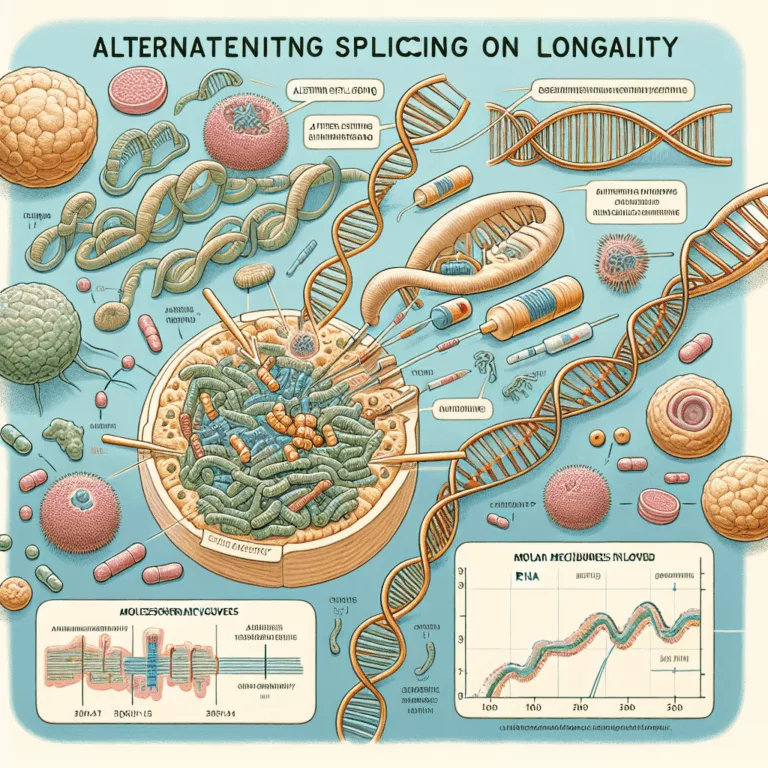
Découvrez comment l’épissage alternatif influence la longévité et son potentiel rôle dans le vieillissement, en révélant des mécanismes moléculaires fascinants.

Cala lève 50 millions de dollars pour transformer le traitement des tremblements grâce à une thérapie neuromodulatrice innovante.
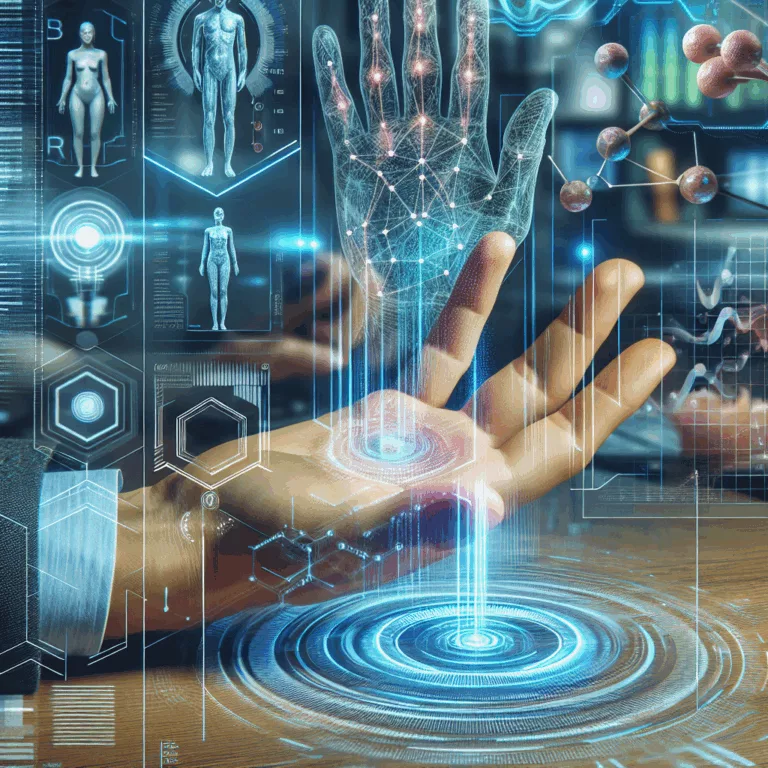
Découvrez comment SkinGPT transforme l’analyse du vieillissement cutané grâce à l’IA, offrant des simulations réalistes pour des choix de vie éclairés.

Telomir Pharmaceuticals acquiert les droits mondiaux de Telomir-1, une thérapie prometteuse pour les maladies oncologiques et liées à l’âge.

Découvrez comment Designs for Health, grâce à un investissement stratégique, renforce son innovation et son développement dans le secteur de la santé.
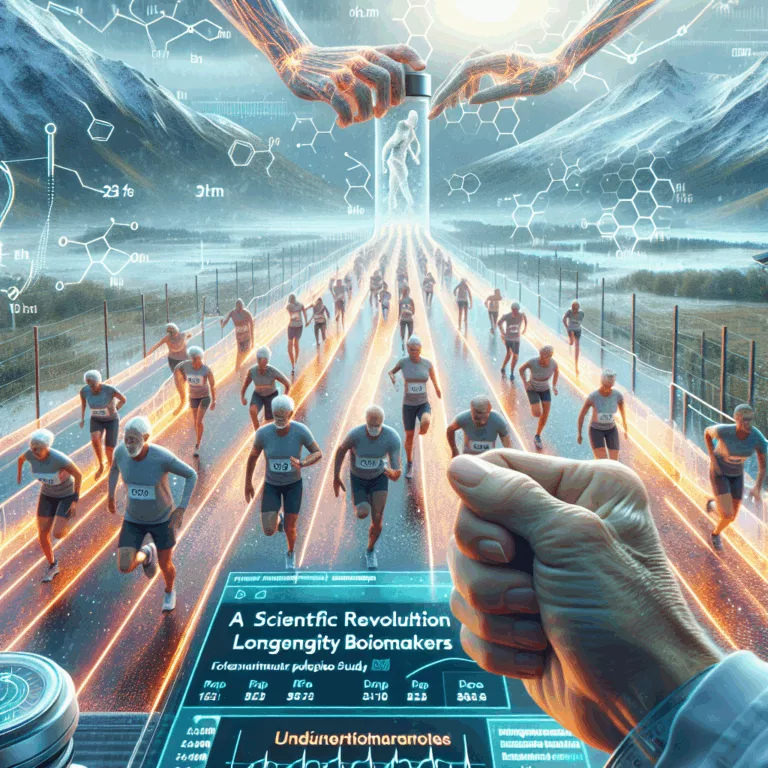
Découvrez comment Rejuve.ai mesure l’impact des thérapies et du mode de vie sur l’âge biologique lors des Infinite Games 2026.

Découvrez comment Adaptyx transforme le suivi de la santé avec un patch portable pour la surveillance moléculaire continue.